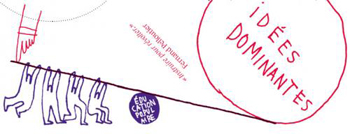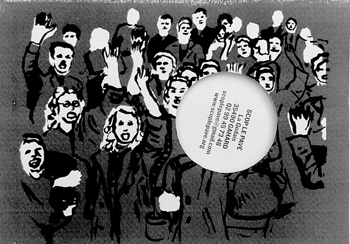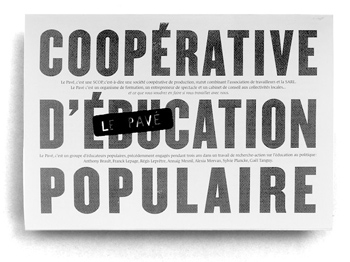Desserrer
les contraintes économiques liées au travail, essayer de le faire
collectivement en leur substituant d’autres
interactions, d’autres rapports entre les gens au quotidien. Se
libérer du travail en cherchant d’autres façons de subvenir à ses
besoins, voire reconsidérer ces besoins en chemin, approfondir
des solidarités en puisant ses forces sur ce temps libéré, voilà en
somme l’idée générale.
Une
idée simple, mais qui se heurte à l’ambiguïté des situations
quotidiennes. Au doute qui subsiste dans l’isolement, et malgré
l’obstination à penser le monde à rebours de ce qu’il est
officiellement, à faire œuvre de volonté plutôt que se laisser traverser
par lui. Il est en effet plus simple de vivre couché que debout,
c’est-à-dire dans notre société capitaliste aspirer au travail, et
si possible un travail intéressant, plutôt que de refuser les
gratifications qui vont avec le travail, du moins quand votre
parcours s’obstine à faire de vous un « employable »… comme c’est
mon cas.
Dans
une telle position je reste étranger aussi bien aux peines du chômeur
involontaire, qu’à l’insatisfaction du travailleur en
quête de reconnaissance, ou d’évolution de carrière. Rat avec les
oiseaux, oiseau avec les rats, mon isolement me protège, mais aussi
m’expose à une vague angoisse d’anomie qui peut survenir
chaque fois que l’ambiance au travail est par trop conviviale, et
qu’il m’apparaît que certains croient plus que ce j’imaginais à
l’utilité de ce qu’ils font, que je reste seul avec mes
convictions qui ne m’aident plus vraiment à m’orienter, à savoir ce
que je dois faire. Malgré la clarté que l’on peut donner à certaines
explications générales, il me semble alors impossible
d’être certain de ce qui se passe vraiment dans la tête des gens qui
travaillent, à quel point ils aiment vraiment ce qu’ils font. Et c’est
devenu aussi finalement ma propre situation : ne
plus savoir ce qu’on pense vraiment, à force d’efforts pour se
rendre conforme aux situations.
D’un
côté, je suis acculé à reconnaître ma différence : là où il s’agit pour
moi de compromis à faire, pour d’autres il
s’agit d’abord de se sentir à l’aise dans le monde qui les entoure
en s’y adaptant. D’un autre côté, il y a aussi quelque chance pour que
cette confusion sur mes propres sentiments ne me soit pas
propre, mais constitue un fond commun qu’il nous faut oser exprimer,
afin d’en sortir, de retrouver une joie de vivre, une disponibilité au
monde. Car il m’est apparu finalement que cette
tristesse à aller au travail avait de moins en moins de
justification, qu’il était de moins en moins possible d’y déployer mes
propres activités, à l’abri dans les angles morts des comptes-rendus
d’activité falsifiés. Il m’est apparu aussi qu’au fur et à mesure
que mon fils grandissait, sa spontanéité et sa curiosité envers le monde
finira bientôt par me questionner et me laisser sans
réponse sur ce que je fais vraiment. Gagner de l’argent ? Oui, mais
pas seulement. Jusqu’à quel point y suis-je obligé ? Car à part de
l’argent, je ramène aussi à la maison un silence,
une monumentale fatigue, une gêne, un pessimisme (même si contenu),
peut-être aussi une forme de malhonnêteté et de mensonge qui peut avoir
ses propres effets nocifs sur un enfant. J’aurais beau
jeu d’incriminer l’économie, si je ne suis plus en mesure d’y
résister, même partiellement (et peu importe avec quelle efficacité),
alors je reste au milieu du gué, et ce n’est plus seulement moi
qui suis concerné par mon indécision, mais mes proches.
La vie quotidienne avec les collègues
L’« ambiance »
a beau être « bonne » (comme on dit, sans jamais préciser ce que c’est
qu’une bonne ambiance)
et la compagnie des autres agréables, parfois même enjouée, les
années ont passé et certaines choses demeurent inchangées, me gênent, me
blesse. Tandis que je m’efforce de passer outre, les même
constats d’accablement ressurgissent toujours, et même parmi les
personnes que j’apprécie vraiment. En premier lieu, la base des
conversations entre collègues, qui sont les jugements sur autrui,
finit toujours par adopter l’unique critère de la compétence des
personnes. On peut tout passer à quelqu’un du moment qu’il « assure »,
qu’il soit compétent dans son travail, qu’il soit
efficace, sans quoi il finira toujours par être jugé négativement,
parce qu’il devient une gêne pour les autres. Et je constate cela sans
ressentiment aucun, n’ayant jamais eu ce problème de ne
pas arriver à exécuter le travail que l’on attendait de moi, et le
seul reproche que l’on ne m’aura jamais fait c’est celui ne pas paraître
« motivé », c’est-à-dire finalement ne pas
assez bien jouer la comédie que l’on joue tous, de toute façon, au
travail. Et c’est là la deuxième chose qui demeure insupportable, après
toutes ces années passées à travailler, c’est cette
façon commune de prendre sur soi le plus souvent, et quand ça va mal
et que l’on ne peut pas faire autrement qu’exprimer quelque chose de
négatif (horreur), ne jamais incriminer le travail en
lui-même, mais le chef et (trop souvent) le collègue qui n’a pas
fait correctement son travail, que sais-je encore, mais jamais la
situation elle-même de captivité dans laquelle nous nous
trouvons collectivement, et qui est là pourtant notre véritable
point commun à nous tous, compétents et incompétents.
Face
à ces deux constantes de la vie quotidienne au bureau, je reste
irrémédiablement isolé. En vouloir au faible, au lent, dans
un tel contexte, je n’y arrive pas, c’est plus fort que moi. Au
travail, j’apprécierai toujours chez autrui la nonchalance, la
maladresse, l’échec, l’incompétence, le travail salopé, qui est
tellement plus difficile à faire que le travail bien fait ! Je
n’arrive pas non plus à penser que, si ça va mal, c’est la faute de
quelqu’un en particulier. La métaphore de la prison est
parlante : peut-on vraiment se reprocher de mal y vivre ? Non, et
encore moins le reprocher aux autres. Il ne s’agit que de survie.
Bien-sûr je comprends que certains puissent apprécier
ce qu’ils font, vouloir construire quelque chose de « collectif »,
je reconnais même qu’il peut parfois y avoir quelque chose
d’authentiquement vivant, parfois, dans les relations que
nous avons entre nous, entre collègues. Mais que l’on puisse s’en
tenir là me sidère, surtout les jours où je constate un zèle généralisé,
une agitation collective de chacun, lorsqu’il est tendu
vers les petits objectifs de sa tâche, peu importe son caractère
dérisoire puisque l’on est sommé de le faire, et que c’est tellement
plus simple de le faire. Du moment que l’on ne puisse rien
nous reprocher. D’où aussi l’acharnement à clarifier sans arrêt le
contenu des tâches. D’où aussi le fait que la rationalisation sans fin
ne rencontre jamais d’opposition véritable, puisqu’elle
est vécue comme la garantie qu’il est encore possible de « bien
faire son travail » et donc que l’on nous foute la paix. Mais l’effort
au travail est une foutaise, tellement la
situation de travail est le résultat d’une gigantesque machinerie
sociale apte à soumettre n’importe qui.
Un
jour nous avons eu une discussion sur la prison : certains la
trouvaient trop confortable, du moins c’est ce qu’ils
soupçonnaient. Cette affirmation était à première vue aberrante et
même révoltante, mais elle avait selon moi un sens caché : le refus de
prendre à bras le corps une réalité simple, à savoir
que la captivité, c’était déjà notre vie, que le simple fait de
sortir de ces bureaux pour rentrer chez nous, au milieu de l’après-midi,
nous était impossible comme si des murs invisibles nous
séparaient du monde extérieur. En arriver à être jaloux de la
condition des prisonniers dans les prisons officielles, et tenir cette
conversation sur notre lieu de travail, c’était implicitement
dire que nous qui étions réputés libres, nous vivions réellement en
captivité et que notre prison était nos bureaux, notre travail. Mais ce
constat pour moi évident n’enlève rien au caractère
déprimant d’une telle dénégation face à sa propre condition. Là où
le véritable prisonnier ne saurait se mentir sur son enfermement, nous,
travailleurs au bureau, devons cheminer longuement avant
de plonger en nous-mêmes pour nous avouer notre absence de liberté.
Bien-sûr,
le meilleur outil de cette dénégation, c’est le calcul. Un mal pour un
bien, et un étalon de mesure tiré du
conformisme et de l’imitation morbide. Dans le calcul économique, la
souffrance au travail est naturalisée sous la notion de « coût », puis
son caractère propre, ce qui s’éprouve
négativement, est effacé par l’abstraction au principe d’un étalon
commun, qui additionne, soustrait et divise des expériences pourtant
incommensurables. Il ne reste alors qu’une grandeur par
quoi tout est rapporté au même signe : le temps, l’argent. Mais
toute cette morbidité, en étant collective, prend un autre sens. Elle
est retournée positivement en un lien social, un
sentiment d’appartenance à un grand tout abstrait (la « société »),
mais peu importe cette abstraction, ce sentiment est réel et il est
partagé. Et on continue à le rechercher. Cette
mutilation que nous avons tous en commun fonde notre communauté de
travailleurs. « Car chacun d’entre nous est là seul dans son trou de
travail, à causer avec son voisin du trou d’à côté, à
aimer sentir près de lui un être vivant qui court les mêmes
mutilations que lui. » (Sortir de l’économie,
n°1). Petits économistes de
notre propre misère, nous avons appris, comme travailleurs, à nous
objectiver nous-mêmes au numérateur d’un calcul coût-avantage de ce qui
n’est plus une vie, mais une mise en rapport abstraite
de nos propres horaires de captivité avec ceux d’autrui, qui fait
de même de son côté, le tout assurant que l’approvisionnement des
magasins soit fait, que la clé dans notre poche ouvre bien le
gite où nous dormirons le soir. Quoique difficilement.
Et
l’on ne pourra même pas s’avouer les uns aux autres, le lendemain,
pourquoi l’on est si fatigués d’être là, d’être revenu
quand même, la peur au ventre, les chiffres plein la tête du loyer,
de la nounou, du casse tête de l’argent dans lequel on tourne tous en
rond, et duquel il y a toujours quelqu’un au bureau pour
clamer la triste et dérisoire sortie : « et si je jouais et gagnais
au loto, là, plus de problème ! ». Et alors, même, on en vient à savoir
apprécier les interstices où se
loge la sociabilité artificielle mais reposante des conversations
dérisoires entre collèges : car il y a en nous une vrai détente, un vrai
soulagement, de se sentir alors quand même vivant,
d’être là. On revient à notre bureau et là c’est tellement simple de
s’occuper puisque, finalement, tout a été prévu, organisé. Ce travail
est pour nous, on s’y loge, on retrouve son fauteuil,
son écran, ses icônes. C’est que l’on habite ici aussi, désormais.
On est respecté, il y a le confort, l’espace des bureaux (plus grands
que nos appartements où tout s’entasse), le café, il
subsiste des restes d’intimités, la superficialité des rapports
humains favorise le colloque intérieur, les sentiments à nos proches,
qui deviennent alors d’autant plus chers que, peut-être, ils
savent reconnaître cette douleur de travailler, douleur qu’à
présent, nous supportons finalement pas trop mal. A croire que nous
sommes courageux. Avons surmonté quelque chose qui se nomme
« aller travailler ». Et c’est pourquoi -ce n’est pas si exagéré
malgré tout ce qui a été dit précédemment- on finit par se sentir
chanceux de pouvoir compter sur ce salaire à la fin du
mois, qui va tomber c’est sûr. Il suffit de refaire la même chose le
lendemain, et c’est facile, oui.