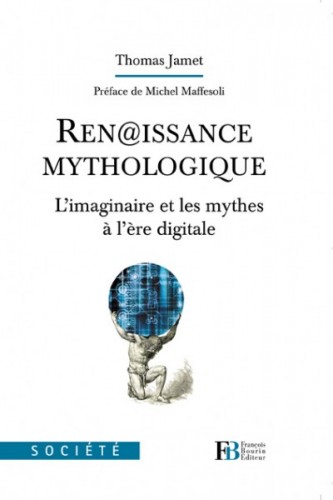La partie introductive de cet
article a été publiée dans le numéro 2 de la version papier
d’Article11. L’entretien qui suit est inédit.
À l’orée des années 1960, dans une demeure exiguë de
paysans du Salento (Midi italien), le documentariste Gianfranco Mingozzi
saisissait [
1] les derniers spasmes d’un mal ancestral porté par la culture populaire méridionale : le tarentisme. La
pizzica, musique stridente, mêlant tambourin et violon, servait à guérir par la transe les femmes affectées, dites « tarentulées » [
2]. Mingozzi suivait de près les sentiers ethnologiques frayés sur
La Terre du remords par le communiste indiscipliné Ernesto De Martino [
3]
quelque temps auparavant. À cette époque, l’hégémonie de la rationalité
intellectuelle bourgeoise – toujours profondément positiviste – se
piquait d’éliminer cet héritage magico-religieux honteux,
essentiellement relégué à l’espace domestique, et de refouler l’une des
tares culturelles associée à «
la question méridionale ».
L’approche démartinienne rompait avec le schème dominant
de compréhension de la transe – réduite à une alternative entre
possession authentique et mauvaise-foi –, afin de l’interpréter comme
une résistance des dominés à une situation historique de misère sociale.
Selon De Martino, le tarentisme protégeait la « présence » [
4]
de l’homme dans son monde en renversant symboliquement plusieurs
couples et figures de l’altérité : catholicisme-paganisme, homme-femme,
bourgeois-paysans et Occident-Orient [
5].
Sa mort précoce en 1965 le laissa sans filiation intellectuelle et
politique, bien qu’il ait ouvert la voie à l’antipsychiatrie et anticipé
les préoccupations constitutives de courants universitaires
anglo-saxons à venir, d’inspiration gramscienne.
Le tarentisme est sorti des limbes de l’oubli un quart
de siècle plus tard, lorsque le sociologue Georges Lapassade porta son
attention sur les états modifiés de conscience, passés et
contemporains [
6].
Cette renaissance académique a accompagné l’émergence d’une
neo-pizzica, mouvement festif, décomplexé, populaire et lucratif. Dans
ce sillage, deux jeunes réalisateurs italien et français, Irene Gurrado
et Jérémie Basset, choisirent d’explorer, au mitan des années 2000, le
terrain démartinien laissé en jachère. Pour le second, cette épopée
documentaire devint, pendant près de cinq ans, le pivot central d’une
quête politique existentielle, et une introspection malicieuse
questionnant la relation du réalisateur à son objet de recherche.
La production du film s’est bâtie progressivement au
travers de dons financiers, de prêts matériels, d’une maigre subvention,
et surtout du RMI qui, au côté de boulots d’appoint, libérait un temps
précieux. Toutes les étapes d’élaboration du film
Latrodectus – "qui mord en cachette" [
7]
- ont été maîtrisées par les auteurs, avec des appuis techniques
extérieurs ponctuels. A posteriori, ils se sont intéressés à la
produzione dal basso [
8],
financement par micro-souscriptions répandu en Italie en réaction au
marasme d’une industrie audiovisuelle crétine. Enfin, l’étalement de la
réalisation, assujetti à la pauvreté des moyens, n’était pas contraint
par l’impératif d’obtenir dare-dare un produit fini. Au contraire,
l’égrènement des saisons a mûri une œuvre exigeante et réflexive. Le
traitement du sujet s’est inscrit dans le temps long, historique.
Latrodectus émet l’hypothèse d’une
continuité entre la transe intime disparue et celle, contemporaine et
collective, qui réunit annuellement dans le Salento, lors de La Notte della Taranta,
quelques cent mille festivaliers, parfois avides consommateurs d’une
tradition recomposée aux allures mystiques. L’énigme reste entière quant
à la dimension "thérapeutique" des rituels modernes, symptômes et/ou
remèdes d’un mal-être social supposé. Néanmoins, le passage de la pizzica
du confinement de la sphère privée à une exhibition publique marchande
apparaît comme un corrélat à l’esprit de notre temps et à son corps
socio-économique.
Extrait de "La Taranta", Gianfranco Mingozzi, 1963
Entretien avec Irene Gurrado, co-auteure et ethnopsychiatre
Avant de parler de votre documentaire, Latrodectus, « qui mord en cachette », peux-tu expliquer ce qu’est l’ethnopsychiatrie ?
L’ethnopsychiatrie a été initiée par Georges Devereux
dans les années 1950-1960. Il s’agit d’étudier les problèmes
psychologiques et psychiatriques des populations migrantes en intégrant
des thématiques comme le déracinement ou les cultures étrangères.
L’approche est interdisciplinaire : par exemple, l’anthropologie, qui en
fait partie, doit permettre d’éclairer les problématiques liées aux
représentations culturelles. Certaines cultures non-occidentales
interprètent la « maladie » d’une manière différente de la nôtre.
L’ethnopsychiatrie rend intelligible des phénomènes comme la transe, la
magie ou la sorcellerie en essayant de nouer des liens avec nos propres
représentations. Elle est née d’une exigence pratique : dans les
hôpitaux certaines maladies des migrants étaient inexplicables pour les
psychiatres. Une explication culturelle, corrélée au vécu des personnes,
était indispensable.
Je suis moi-même une migrante, venue d’Italie du Sud en
France. Avant d’étudier la culture des autres, il fallait que
j’interroge ma propre culture. Pizzica et taranta
étaient un terrain d’analyse personnel à partir duquel j’ai questionné
mes racines. Cela m’a aussi formée sur une thématique précise, validée
auprès de professeurs en ethnopsychiatrie qui ne connaissaient pas le
tarentisme. Il y a une dizaine d’années encore, cette pratique était
inconnue des anthropologues italiens et français. Elle n’était pas à la
mode comme aujourd’hui.
Avec Jérémie Basset, réalisateur, comment avez-vous décidé d’élaborer un documentaire sur cette thématique ?
Nous étions amis. À l’époque, il venait de terminer la
formation cinéma de l’école Louis Lumière à Paris, et j’entamais des
études en ethnopsychiatrie à l’université Paris 8. Jérémie désirait
d’une part faire un film documentaire où certains états modifiés de
conscience soient étudiés comme ressource de la vie, où l’on puisse
mesurer leur utilité, leur apport positif, leur apport constructeur ; et
il voulait d’autre part - pour des raisons intuitives et personnelles -
réaliser un film en lien avec la culture du sud de l’Italie. Je lui ai
proposé des thématiques, notamment la
pizzica, la
taranta
et les rituels sur lesquels j’avais entamé une étude. Je partais d’une
base très académique et universitaire, puisque je présentais l’historien
Ernesto De Martino lors de mon DU (Diplôme universitaire) aux
psychiatres qui m’encadraient. À ce moment-là, ce n’était pas vraiment
une recherche, mais plutôt la découverte d’un sujet. Nous ne
connaissions pas encore les rétrospectives italiennes actuelles autour
du mythe, du folklore et du festival
La Notte della Taranta.
Jérémie connaissait un peu l’Italie du Sud et se
rappelait de cette danse ; il y portait un intérêt personnel. Il est
parti sur le terrain et j’ai approfondi mes recherches en sciences
humaines. Me spécialisant en ethnopsychiatrie, je partageais avec lui
mes connaissances anthropologiques sur les phénomènes de transes et les
rituels. Il entamait de son côté une réflexion sur sa propre vie autour
d’une démarche esthétique vis-à-vis des états de transe. Il a alors vécu
en Italie du Sud, entre Naples et le Salento ; immergé, il a pu toucher
du doigt le vécu des Italiens du Sud. Nous communiquions par mails de
façon continue et nous échangions de vive voix lors de séjours à Paris.
Je préparais les entretiens avec les professeurs, tandis que Jérémie
prenait contact avec les acteurs locaux.
Nous avons élaboré les entretiens en diverses étapes, divers lieux,
notamment via une semaine passée ensemble dans le Salento. Nous avions
peu de temps, et avons opéré une sélection de personnes à interroger.
Comment avez-vous constitué le panel d’intervenants ?
Le choix s’est affiné doucement à l’image de tout le
travail de ce film, pour lequel nous avons choisi de prendre le temps de
comprendre, de sentir - autant que possible - ce que nous faisions.
Nous sommes partis à l’aventure. Par le biais des sciences humaines,
j’avais une idée du schéma à suivre. Par exemple, je souhaitais
interviewer un historien pour retracer l’histoire de la
pizzica.
Je désirais aussi suivre les traces d’
Ernesto De Martino qui, dans son
enquête à la fin des années 1950, avait fait le choix de
l’interdisciplinarité. Je voulais retracer son parcours en interrogeant
un historien, un ethnomusicologue et un sociologue.
Nous avons également rencontré des héritiers de la
pratique du tarantisme, qu’aujourd’hui on appelle « néo-tarantisme ».
Sur le terrain, la réalité était très hétérogène, et il y avait de
nombreux courants. Certains puristes affirmaient que la pratique
actuelle est une continuation de la tradition ; d’autres soutenaient que
non, que c’est un épiphénomène, une mode, un folklore alimentant
l’identité locale. Ce partage se retrouvait aussi au-delà des sciences
humaines. Nous avons ainsi rencontré beaucoup de musiciens : certains se
disaient traditionalistes, d’autres innovateurs dans la tradition. Des
interrogations nouvelles sont sorties de ces rencontres : qu’est-ce que
la tradition ? qu’est-ce que l’innovation ? Il fallait se repérer au
sein des différents discours.
Et puis, le grand festival, La Notte della Taranta,
emblème actuel des discours des intellectuels et des politiques sur le
sujet, est apparu comme incontournable. Son rayonnement a dépassé le
cadre local du Salento, puisqu’il est très fréquenté : près de 100 000
personnes venant du monde entier s’y rendent chaque été. De nombreux
villages participent. Les artistes locaux, censés être les protagonistes
et les continuateurs de la tradition, sont mis de côté avec des
rémunérations ridicules au profit de la publicité et de l’argent investi
pour des d’artistes qui n’ont rien à voir avec la pizzica,
mais qui donnent une certaine ampleur médiatique au festival. Les
dégradations occasionnées par les touristes qui envahissent le
territoire sont problématiques. Les discours politiques locaux tenus
n’en tient pas vraiment compte. Cette question était nouvelle pour
nous : nous ne nous étions pas interrogés sur le phénomène et la mode
« néo » initialement.
Sur quels témoignages vidéos ou photographiques vous appuyez-vous ? Quel est l’état des archives existantes ?
Nous avons utilisé des extraits de
La Taranta de Gianfranco Mingozzi (1963) [
9]. Ce documentariste a été en contact avec Ernesto De Martino une année après l’enquête de
La Terre du remords.
Mingozzi s’est inspiré du travail de De Martino pour réaliser son film.
Les images du film de Mingozzi ont été raccourcies pour un montage de
vingt minutes, ce qui signifie qu’il reste des archives. Ces dernières
restent difficiles d’accès. Par ailleurs, les archives photos sont
importantes puisque, un photographe était présent dans l’équipe
accompagnant De Martino lors de son enquête, Franco Pinna.
Qui est Ernesto De Martino, ce chercheur dont vous suivez implicitement le cheminement dans le film ?
Ernesto De Martino était un historien des religions,
familier des travaux d’Antonio Gramsci. Il est parti étudier le
tarentisme comme ethnologue. Il avait un parcours de militant pour les
classes populaires, voulait faire évoluer la situation de l’Italie du
Sud, engoncée aux marges de la modernisation de la société italienne. Il
est d’abord parti étudier ce qu’il restait de la magie. Il a sorti une
trilogie, avec notamment les livres Sud et magie et La Terre du remords. Un autre opus, Monde populaire et magie en Lucania,
est une recherche typiquement ethnographique pour laquelle il a
recueilli toutes les données sur les composants magico-religieux dans la
religion d’un district situé à côté du Salento, la Lucania, avant d’en
faire un essai philosophique sur la magie. C’est un bouquin
extraordinaire, comme Sud et magie, où il se
positionne en tant qu’intellectuel occidental. L’anthropologie de
l’époque est marquée par des représentations occidentales sur des
populations « exotiques ». De Martino, en tant qu’intellectuel d’Italie
du Sud, a une réflexion personnelle sur sa position. Il se confronte à
un monde auquel il appartient, mais dont il est aussi éloigné puisqu’il
vient de la grande bourgeoisie. La Terre du remords
marque sa découverte de ces rituels. Lors de son enquête de terrain au
croisement des années 1950-1960, il a collaboré avec un violoncelliste
qui soignait les femmes tarentulées, le maestro Luigi Stifani.

L’idée de notre documentaire était aussi de donner leurs
places aux rencontres et à leurs enchaînements : nous avons rencontré,
entre autres, la fille du maestro Stifani. Aujourd’hui complètement
marginalisée, elle accepté de nous voir avec réticence, mais cette
rencontre reste emblématique : ses paroles sont une composante
essentielle du film. Elle se plaint beaucoup de la non-reconnaissance du
travail de son père, de la falsification musicale au profit du
tourisme. Son père était inscrit dans une parcours thérapeutique de
croyances et de credo. Elle n’a pas voulu se laisser filmer, mais a
accepté l’enregistrement sonore, et nous avons donné une place
particulière à ses paroles. Ça nous a plu parce qu’elle représente
encore le tabou, au-delà de l’effet touristique : la laisser s’exprimer
revient à présenter un espace qui est de l’ordre du privé, du sacré.
Qu’est-ce qui différencie le regard d’Ernesto De Martino de celui d’autres anthropologues ?
Personne ne s’était intéressé au phénomène avant De
Martino, si ce n’est un psychiatre au début du siècle. Ce dernier avait
diagnostiqué la chose comme une sorte d’hystérie culturelle locale des
femmes. Après ça, rien d’autre. Pour l’étudier, De Martino s’est plongé
dans la littérature médicale produite depuis la Grèce antique, mais il
s’est aussi appuyé sur d’autres disciplines : dans son équipe, on
trouvait un psychologue, une assistante sociale, deux psychiatres, un
photographe. Il voulait poser un regard interdisciplinaire sur les cas
rencontrés.
Dans La Terre du remords, il affirme
ne pas vouloir analyser ça sous le prisme du rapport dominé/dominant,
en tant qu’occidental qui observe des populations marginales en Italie.
Il a souhaité sortir de ce carcan et penser cette culture de manière
relativement autonome.
Pour tous les anthropologues de l’époque, il y a une ambivalence.
D’un côté, ils ont la volonté de ne pas avoir un regard méprisant,
occidental, d’intellectuel cultivé, rationaliste. De l’autre, ils ne
peuvent pas s’empêcher d’avoir ce rapport. Le livre de De Martino est
justement excellent dans sa volonté d’aller au-delà d’un regard
ethnocentriste, malgré le fait qu’il ne puisse pas avoir un regard
vraiment autre en raison de son inscription historique et culturelle
dans une époque donnée. L’envie de sortir de là s’est traduite par
l’approche interdisciplinaire.
La réflexion de De Martino a préparé le discours et les
pratiques de l’antipsychiatrie qui arrive à la fin des années 1960.
L’Italie du Sud fut un terrain d’expérimentation fertile dans ce
domaine. Il faut rappeler que les électrochocs étaient alors une
thérapie commune pour soigner la « folie ». Mais cela nous amène un peu
loin...
Y a-t-il eu une transition entre la fin des années 1960 et la résurgence du phénomène à l’orée des années 1990 ?
De Martino est mort d’un cancer foudroyant quatre ans
après la sortie de son livre. Il a laissé son étude orpheline. Ensuite,
l’Italie du Sud a connu une forme de refoulement culturel pendant
quarante ans. Le livre est tombé dans l’oubli, il n’a pas trouvé d’écho.
Cela renvoie au fantasme d’une Italie du Sud aux marges de la
civilisation : il y a encore quelques années, des femmes pratiquaient
des rituels qu’on ne savait même pas nommer. On ne parlait pas de
rituels de transe à l’époque. C’était des choses qu’on ne savait pas
décrire, relevant du tabou, surtout pour les intellectuels.
Le premier qui, après De Martino, a commencé à retracer
l’histoire du tarentisme fut Georges Lapassade, psycho-sociologue
français mort il y quelques années. Il étudiait les cérémonies gnawa au
Maroc et travaillait sur les centres sociaux en Italie. Il a découvert
cette pratique par l’étude de De Martino et l’a relancé. Il voulait
mettre en lumière cette pratique de transe, non pas comme une honte,
mais comme une ressource pour les intellectuels et les artistes. Un
grand nombre de musiciens se sont inspirés des Gnawas, des pratiques de
transe méditerranéenne : ils ont repris la tradition avec le support
intellectuel de Lapassade et ont relancé cette tradition sur le plan
musical.
Georges Lapassade
C’est la même chose pour le tarentisme : les
intellectuels se sont progressivement intéressés au phénomène, notamment
dans le courant des années 1990. Aujourd’hui, une élite se dit
héritière du phénomène. On est passé d’un phénomène local honteux,
marginalisé et dissimulé, à une explosion de répertoires d’où sort une
culture fière d’un passé très riche.
Entre les années 1960 et 1990, il n’y avait pratiquement
rien, hormis un musicologue que l’on interroge dans le film : Ruggiero
Inchingolo. Il étudiait à Bologne avec l’ethnomusicologue italien le
plus important de l’époque. Sous son patronage, il a fait sa thèse sur
le maestro Luigi Stifani, qui avait travaillé sur la retranscription des
rituels musicaux. Le maestro Stifani, barbier, avait une écriture très
personnelle. Dans notre documentaire, Inchingolo explique la
signification de l’usage du tambourin, du violon, et des effets qu’ils
ont sur les femmes pendant les rituels. Comment ces musiciens
arrivaient-ils, par la transe, à guérir ces femmes de la morsure et du
venin de l’araignée ? Il a fait partie des premiers musiciens à mettre
en lumière le phénomène, à retracer le travail inachevé de De Martino.
Comment avez-vous démêlé sur le terrain les différentes interprétations et utilisations du néo-tarantisme ?
Nous avons eu des difficultés à démêler tous les
discours. D’autant que c’est désormais un phénomène très touristique.
Dans ces conditions, comment parler de rituel ? La femme que décrit De
Martino est très oppressée, elle subit une forte violence psychologique,
mène une vie très dure et travaille dans les champs. Pendant le rituel,
cette même femme renverse un peu l’ordre social ; à ce moment-là, elle
fait l’histoire. Aujourd’hui, le statut de la femme a évolué : elle ne
travaille plus dans les champs, son rapport à l’homme et à l’emploi a
changé, la répression sexuelle n’est plus la même. Le contexte
historique est différent. Le rituel aussi, comme le discours et la
forme. Dans le film, nous avons laissé une question ouverte : peut-on
lire les festivals de néo-pizzica en Italie du Sud
comme des rituels contemporains ? Des rondes s’organisent, la fièvre
gagne les musiciens, l’ivresse les atteint tandis que femmes et hommes
dansent. Ces premières polarisent le regard.
Mais est-ce qu’il y a encore un malaise ? Je ne sais pas si l’on
peut répondre, tant la forme a changé. Dans une réalité agricole, très
fermée sur elle-même, il n’y avait qu’une possibilité de regard ; alors
qu’aujourd’hui on assiste à une fragmentation des manifestations de
souffrance.
Georges Lapassade s’est intéressé à cela, mais aussi à la naissance du rap, de la techno [10]...
Pour lui, ce sont des rituels de transe contemporains,
occidentaux, révélateurs de nos façons de vivre et de nos malaises.
Lorsque nous pensons à la transe, nous pensons toujours à la transe
traditionnelle, que nous voyons dans les films ethnographiques. Or nous
connaissons d’autres formes d’états modifiés de conscience. Nous les nommons ainsi car, en Occident, la transe est très « pathologisante ». Nous évitons de parler de transe, terme trop exotique.
De même, quand Georges Lapassade rencontrait des Gnawas, il avait du
mal à employer le mot. Eux étaient seulement intéressés par l’état de
possession. Pour les populations qui pratiquent la transe, le terme ne
veut rien dire. Notre difficulté dans le film est justement de
demander : mais qu’est-ce que ce malaise ? Que font ces femmes qui se
trainent par terre et semblent subir les pires atrocités du monde ?
Quelle forme peut prendre la transe aujourd’hui ? Nous avons des façons
différentes d’extérioriser les moments difficiles que nous traversons
dans notre vie. Ou de ne pas les extérioriser. C’est peut-être une
souffrance que de ne pas extérioriser un malaise... Nous ne pouvons pas
parler de guérison ou de disparition des rituels et des malaises. Le
malaise est toujours là ; il faut arriver à le situer.
Tu parlais d’inversion de l’ordre social à l’époque : qu’en est-il aujourd’hui ?
Le rituel que l’on voit dans La Taranta
est le rituel thérapeutique. Aujourd’hui c’est une danse de séduction ;
ça l’était peut-être à l’époque aussi, mais les formes de séductions
changent avec le temps. La femme est toujours protagoniste, parce qu’il
reste un entourage qui la met au centre : pour le plaisir des yeux, le
plaisir des gens, parce que c’est la fête. C’est elle qui renverse
l’ordre social, elle est héritière d’une forte oppression. En tant
qu’Italienne du sud, je suis prise moi aussi dans cet héritage de femmes
situées dans l’ombre transmise par nos mères, nos grands-mères.

Mais dans le rituel actuel, tout amène la femme vers la
lumière : les habits, les mouvements, le fait de choisir l’homme à
séduire. C’est un renversement différent. Il faut retracer la position
de la femme... et de l’homme. Si la femme a une place, l’homme en a une
autre. C’est une question de genre et de place. Est-ce propre à l’Italie
du Sud ? Une historienne des religions, Silvia Mancini, explique qu’on
est passé aujourd’hui de rituels de possession à des récits de
possession. C’est une héritière de De Martino. On ne parle plus de
rituels aujourd’hui. Et de nombreuses questions se posent : Que sont
devenues ces histoires de femmes autour des rituels de possession ? Où
en est-on de cette transmission intergénérationnelle ? Comment peut-on
lire ces rituels ? Comme lire la pizzica ? Le
tarentisme ? Les gestes et les symboles sont interprétés en fonction du
contexte historique. Ils sont manipulés par les gens eux-mêmes, remis
sur la scène de façon différente ; mais un lien est à faire. C’est
peut-être la force du mythe, du symbole. La taranta a été un symbole pendant des siècles et des siècles. En cinquante ans, elle ne peut pas avoir disparu.
Historiquement, quelle fut la position de l’Église par rapport à ces « rites païens » ?
Comme pour tous les phénomènes syncrétiques, il y a
toujours un pliage, un remaniement des situations. L’Église en Italie du
Sud était très métissée, avec des héritages des orthodoxes, de l’Empire
ottoman, etc. De nombreux rituels païens ne rentraient pas dans le
schéma catholique. Quand la religion est arrivée, il y avait des
centaines de croyances et de pratiques avec lesquelles il fallait
composer parce qu’elles étaient trop prégnantes pour être modifiées ou
éradiquées. Qu’a fait l’Église ? Elle a essayé de greffer l’élément
catholique. Fin 1700, un sanctuaire pour Saint-Paul est réalisé par les
Jésuites du royaume de Naples. Ceux-ci allaient dans le Salento pour
coucher sur papier la musique, la mettre sous forme de partition [
11].
Aux rites liés au tarantisme fut attribuée la figure de
Saint-Paul. Un moyen de plier le rituel à une fonction catholique. La
musique restait quand même interdite, voire réprimée. Une femme qui se
traîne par terre en transe, voilà qui n’était pas tolérable dans les
rituels chrétiens.
À la période moderne, les Jésuites appelaient les Pouilles les Indes
de l’Europe tant les pratiques cultuelles étaient sauvages et non
cadrables. Ce regard extérieur était très fort... pour ne pas employer
le terme de « colonisation ».
Des analogies avec d’autres pays sont-elles possibles ?
Oui, avec des cas se présentant en Afrique et au Brésil,
mais il faut rester prudent. Les syncrétismes religieux où des éléments
catholiques se mélangent avec des rituels païens héritiers de la Grèce
antique, comme les Baccantes ou les Ménades, sont propres à l’Italie du
Sud, et on trouve des références à ces rites passés dans les thèses de
Platon.
Si on regarde ailleurs, on note des renouveaux, avec une
massification du folklore, des politiques locales qui investissent de
l’argent : c’est le cas en Haïti avec le vaudou, au Maroc avec les
Gnawas, ou à Bahia, au Brésil. La différence, en Italie du Sud, c’est
qu’on a euthanasié un certain type de pratique – la psychiatrique – pour
privilégier la plus commerciale. Dans d’autres pays, les pratiques
touristiques se partagent avec les anciennes : l’une n’enlève pas
l’autre. Il n’y a pas de remords. À cet égard, le choix du titre de
l’ouvrage de De Martino - La Terre du remords - était parfait. Malheureusement, celui-ci, comme emblème, appartient aussi aux produits locaux.
Confrontés aux réactions lors des projections de film,
nous nous sommes aperçus qu’il y a toujours un remords à parler du
phénomène passé, un regret. La souffrance des femmes tarentulées est
occultée. Cette ambivalence de fond nous habite. Il était – et il est –
difficile de parler de ça en Occident. Dans le film, nous avons laissé
une porte ouverte au spectateur pour qu’il aille chercher lui-même des
pistes de réflexion. Il faut chercher au fond de nous cette réponse qui
n’appartient à personne.
Chronologie de production du film, par Jérémie Basset, réalisateur
Automne 2003 :
Nous commençons à parler du film avec Irene. Elle m’introduit dans
le monde du tarentisme et de l’anthropologie, et à partir de là je
débute l’écriture du film et d’un dossier pour trouver des financements.
Juin 2004 :
Tournage de l’entretien avec Georges Lapassade alors que l’idée du
film est encore en cours de maturation. Mais Georges Lapassade,
octogénaire, connait de sérieuses difficultés de santé. Nous allons deux
ou trois fois parler avec lui, puis nous avons tourné pendant deux
heures dans sa cuisine.
Eté 2005 :
Tournage de toutes les séquences sauf le Super 8 à Naples : dix
jours de tournage avec deux techniciens (image/son), car je devais mener
les entretiens, et deux « assistants réalisateurs », parce qu’on devait
faire beaucoup de choses en peu de temps.
Automne 2005 à printemps 2009 :
Montage avec trois monteurs successifs, dont moi, pour une durée approximative totale de six mois.
Printemps 2007 :
Tournage Super 8 à Naples.
Printemps 2009 :
Mixage et étalonnage.
Automne 2010 :
Création de l’association les Films du lierre, ayant pour objectif d’éditer le DVD de Latrodectus
(suite à la demande d’un distributeur), d’encadrer et de soutenir de
futurs projets, et d’améliorer la visibilité de mon travail de
réalisateur par le biais d’un site internet.
Décembre 2010 :
Edition du DVD du film
Été 2011 (à venir) :
Mise en ligne du site internet des Films du lierre.
-
Distribution :
Rambalh Films (pour les zones francophones) et www.cinemautonomo.org (pour l’Italie).