"La performance et la barbarie sont si étroitement mêlés dans la culture que seule une ascèse barbare à l’encontre de la culture et de ses matrices permet d’entrevoir l’autre face du monde. "
Inakomyliachtchi
Inakomyliachtchi
"L’esthétique – comme dimension du symbolique devenue à la fois arme et théâtre de la guerre économique – substitue le conditionnement des hypermasses à l’expérience sensible des individus psychiques ou sociaux. L’hypersynchronisation conduit à la perte d’individuation par l’homogénéisation des passés individuels, en ruinant le narcissisme primordial et le processus d’individuation psychique et collective : ce qui permettait la distinction du je et du nous, désormais confondus dans l’infirmité symbolique d’un on amorphe."
Bernard Stiegler
Bernard Stiegler
"Maintenant l’homme normal sait que sa conscience devait s’ouvrir à ce qui l’avait le plus violemment révolté :
ce qui, le plus violemment, nous révolte, est en nous."
Georges Bataille
ce qui, le plus violemment, nous révolte, est en nous."
Georges Bataille
« Partout où règne le spectacle, les seules forces organisées sont celles qui veulent le spectacle. Aucune ne peut donc plus être ennemie de ce qui existe, ni transgresser l’omerta qui concerne tout. »
Guy DEBORD
Guy DEBORD
«Est-ce que la proposition honnête et modeste d’étrangler le dernier jésuite avec les boyaux du dernier janséniste ne pourrait amener les choses à quelque conciliation ?»
Lettre du curé Jean Meslier à Claude-Adrien Helvétius, 11 mai 1671.
« Nous supposons également que l’art ne peut pas être compris au travers de l’intellect, mais qu’il est ressenti au travers d’une émotion présentant quelque analogie avec la foi religieuse ou l’attraction sexuelle – un écho esthétique. Le goût donne un sentiment sensuel, pas une émotion esthétique. Le goût présuppose un spectateur autoritaire qui impose ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas, et traduit en « beau » et « laid » ce qu’il ressent comme plaisant ou déplaisant. De manière complètement différente, la « victime » de l’écho esthétique est dans une position comparable à celle d’un homme amoureux, ou d’un croyant, qui rejette spontanément les exigences de son ego et qui, désormais sans appui, se soumet à une contrainte agréable et mystérieuse. En exerçant son goût, il adopte une attitude d’autorité ; alors que touché par la révélation esthétique, le même homme, sur un mode quasi extatique, devient réceptif et humble. »
Marcel DUCHAMP
Lettre du curé Jean Meslier à Claude-Adrien Helvétius, 11 mai 1671.
« Nous supposons également que l’art ne peut pas être compris au travers de l’intellect, mais qu’il est ressenti au travers d’une émotion présentant quelque analogie avec la foi religieuse ou l’attraction sexuelle – un écho esthétique. Le goût donne un sentiment sensuel, pas une émotion esthétique. Le goût présuppose un spectateur autoritaire qui impose ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas, et traduit en « beau » et « laid » ce qu’il ressent comme plaisant ou déplaisant. De manière complètement différente, la « victime » de l’écho esthétique est dans une position comparable à celle d’un homme amoureux, ou d’un croyant, qui rejette spontanément les exigences de son ego et qui, désormais sans appui, se soumet à une contrainte agréable et mystérieuse. En exerçant son goût, il adopte une attitude d’autorité ; alors que touché par la révélation esthétique, le même homme, sur un mode quasi extatique, devient réceptif et humble. »
Marcel DUCHAMP
Affichage des articles dont le libellé est capital culturel. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est capital culturel. Afficher tous les articles
mardi 31 janvier 2012
vendredi 4 novembre 2011
L'enfumage marxiste (recensions de Makhaïski)
À
chaque fois que les intellectuels en lutte contre le capitalisme ont,
selon l’expression consacrée, « rejoint les rangs du prolétariat », ce
fut à une condition : marcher en tête. Ce qui les place naturellement en bonne position lorsque le « parti d’avant-garde » devient État.
À tous ceux qui s’étaient longuement demandé s’il fallait ou non « désespérer Billancourt » avant de changer de discours pour rassurer Passy, Makhaïski répondit par avance en des termes qui n’ont rien perdu de leur pertinence. « Partout les socialistes s’efforcent de suggérer aux ouvriers que leurs seuls exploiteurs, leurs seuls oppresseurs, ne sont que les détenteurs du capital, les propriétaires des moyens de production. Pourtant, dans tous les pays et États, il existe une immense classe de gens qui ne possèdent ni capital marchand ni capital industriel et, malgré tout, vivent comme de vrais maîtres. C’est la classe des gens instruits, la classe de l’intelligentsia. » Ce dont le « travailleur intellectuel » dispose, en effet, et qu’il cherche à faire fructifier au mieux de ses intérêts, c’est ce que Pierre Bourdieu appelle le « capital culturel », capital de connaissances qu’il a acquises grâce au travail des ouvriers, comme le capitaliste son usine. Car « pendant qu’il étudiait à l’université, et voyageait pour la “pratique” à l’étranger, les ouvriers, eux, se démenaient à l’usine, produisant les moyens de son enseignement, de sa formation. […] Il vend aux capitalistes son savoir-faire pour extraire le mieux possible la sueur et le sang des ouvriers. Il vend le diplôme qu’il a acquis de leur exploitation » ; à moins qu’il ne préfère prendre place dans la cohorte des « agents mercenarisés par l’État ».
Et quand des « travailleurs intellectuels » se rallient à la « cause du prolétariat » parce qu’ils jugent insuffisamment rétribuée ou reconnue la qualité des services rendus à la classe dirigeante du moment, c’est encore leur intellect qu’ils mobilisent pour masquer leurs plans et leurs calculs de « classe dirigeante potentielle, de futur propriétaire des biens pillés au cours des siècles. Ce n’est pas pour rien que l’intelligentsia a en main toutes les connaissances et sciences ». Parmi les sciences « socialistes » élaborées pour tromper le prolétariat, il en est une qui s’attire tout particulièrement les foudres de Makhaïski : le marxisme.
Selon Makhaïski, la « première tâche du marxisme est de masquer l’intérêt de classe de la société cultivée, lors du développement de la grande industrie ; l’intérêt des mercenaires privilégiés, des travailleurs intellectuels dans l’État capitaliste ». Kautsky, Plékhanov et Lénine ont parfaitement su traduire les aspirations de l’élite du savoir à prendre la succession des capitalistes au nom d’une « raison historique » incarnée dans un développement industriel inéluctable, car régi par des lois se situant « au-dessus de la volonté des hommes » et identifié au progrès scientifique, technique, et donc social. Mais il serait vain de ne voir dans cette conversion du socialisme scientifique en religion d’une nouvelle classe ascendante la trahison de la pensée du père fondateur par des héritiers plus ou moins légitimes. Marx lui-même, en effet, aurait contribué à établir cette mystification, en particulier en occultant – pour la légitimer – l’origine de la rémunération des « travailleurs intellectuels » : le produit non payé du labeur des prolétaires. C’est pour obtenir une plus grande part de la plus-value qui leur est extorquée que « l’armée des “mercenaires” privilégiés du capital et de l’État capitaliste se trouve en opposition avec ces derniers à l’occasion de la vente de ses connaissances, et agit, pour cette raison, à certains moments de la lutte, comme détachement socialiste de l’armée prolétarienne anticapitaliste ».
Plus clairvoyant que les idéologues, dont les diverses interprétations du « phénomène stalinien » devaient fleurir par la suite dans le champ de la théorie marxiste, Makhaïski a vite découvert ce qui demeure encore opaque aux yeux de ces derniers : « L’absence de propriété privée des moyens de production ne résout en rien la question de l’exploitation, même si on appelle cet état de fait, dans un contexte différent, une “production socialisée”. » Et ce n’est pas pour rien qu’il appelle la masse ouvrière à se soulever de nouveau pour ses « exigences précises de classe » contre la « bourgeoisie démocratique d’État ». Qu’il utilise l’expression de « socialisme d’État » au lieu de celle de « capitalisme d’État » pour caractériser cette « ère nouvelle de la domination de classe des travailleurs intellectuels » n’a, sous cet angle, qu’une importance secondaire, sauf pour ceux qui aiment à ne considérer que les mots pour ne pas avoir à envisager les choses.
Il va de soi que, pour l’intelligentsia, l’État « socialiste », ce ne peut être qu’elle. Mais il fallait aussi convaincre les masses que c’était le leur. La « science marxiste » va servir à poser un signe d’égalité entre le rôle dirigeant de la classe ouvrière et celui de ses dirigeants. Ainsi les prétentions de l’intelligentsia révolutionnaire seront-elles sublimées en « mission historique » du prolétariat dont elle aura épousé la cause, non sans avoir introduit « de l’extérieur », au cas où il en aurait douté, la « conscience politique » qui lui manquait. Cet accouplement tératologique va accoucher d’un monstre : le Parti-État qui, pour aider la classe ouvrière à accomplir sa fameuse « mission », « s’appuiera » sur elle au point de l’écraser.
Ainsi s’explique la réceptivité des intellectuels à l’égard du marxisme : exaltés à l’idée de faire enfin plein usage de leurs compétences, une fois délivrés de l’humiliant contrôle des propriétaires, des industriels et des banquiers « privés », ils saluent dans l’avènement du « socialisme » l’avènement de leur propre transcendance. Quant au prolétariat, réduit par les soins des théoriciens à une abstraction historico-philosophique, il ne lui restera plus qu’à développer, contre ses « représentants », son mouvement spontané pour l’autodétermination. Mais pour que son auto-activité ne soit pas que défensive, il lui faut préserver une autonomie de pensée sans cesse remise en cause par une intelligentsia qui, non contente de le priver des produits de son travail, le prive aussi de son identité sociale, beaucoup plus efficacement que peut le faire la bourgeoisie. Car le fait que, pour la première fois dans l’histoire, l’intelligentsia soit en train de devenir une classe dominante est lourd de conséquences. En empêchant la formation d’intellectuels organiques des classes opprimées et le développement d’une vision du monde qui leur serait propre, le règne de l’intelligentsia ne rend-t-il pas problématique la saisie de la réalité sociale autrement que dans les termes de l’idéologie dominante ?
Aussi faut-il souligner que l’autoconnaissance de la société est menacée de crise dès lors que le groupe social qui, normalement, assure la production, le maintien et la transmission de la culture et des finalités sociales, s’organise en une classe dont l’activité cognitive est subordonnée à ses propres intérêts de classe.
À tous ceux qui s’étaient longuement demandé s’il fallait ou non « désespérer Billancourt » avant de changer de discours pour rassurer Passy, Makhaïski répondit par avance en des termes qui n’ont rien perdu de leur pertinence. « Partout les socialistes s’efforcent de suggérer aux ouvriers que leurs seuls exploiteurs, leurs seuls oppresseurs, ne sont que les détenteurs du capital, les propriétaires des moyens de production. Pourtant, dans tous les pays et États, il existe une immense classe de gens qui ne possèdent ni capital marchand ni capital industriel et, malgré tout, vivent comme de vrais maîtres. C’est la classe des gens instruits, la classe de l’intelligentsia. » Ce dont le « travailleur intellectuel » dispose, en effet, et qu’il cherche à faire fructifier au mieux de ses intérêts, c’est ce que Pierre Bourdieu appelle le « capital culturel », capital de connaissances qu’il a acquises grâce au travail des ouvriers, comme le capitaliste son usine. Car « pendant qu’il étudiait à l’université, et voyageait pour la “pratique” à l’étranger, les ouvriers, eux, se démenaient à l’usine, produisant les moyens de son enseignement, de sa formation. […] Il vend aux capitalistes son savoir-faire pour extraire le mieux possible la sueur et le sang des ouvriers. Il vend le diplôme qu’il a acquis de leur exploitation » ; à moins qu’il ne préfère prendre place dans la cohorte des « agents mercenarisés par l’État ».
Et quand des « travailleurs intellectuels » se rallient à la « cause du prolétariat » parce qu’ils jugent insuffisamment rétribuée ou reconnue la qualité des services rendus à la classe dirigeante du moment, c’est encore leur intellect qu’ils mobilisent pour masquer leurs plans et leurs calculs de « classe dirigeante potentielle, de futur propriétaire des biens pillés au cours des siècles. Ce n’est pas pour rien que l’intelligentsia a en main toutes les connaissances et sciences ». Parmi les sciences « socialistes » élaborées pour tromper le prolétariat, il en est une qui s’attire tout particulièrement les foudres de Makhaïski : le marxisme.
Selon Makhaïski, la « première tâche du marxisme est de masquer l’intérêt de classe de la société cultivée, lors du développement de la grande industrie ; l’intérêt des mercenaires privilégiés, des travailleurs intellectuels dans l’État capitaliste ». Kautsky, Plékhanov et Lénine ont parfaitement su traduire les aspirations de l’élite du savoir à prendre la succession des capitalistes au nom d’une « raison historique » incarnée dans un développement industriel inéluctable, car régi par des lois se situant « au-dessus de la volonté des hommes » et identifié au progrès scientifique, technique, et donc social. Mais il serait vain de ne voir dans cette conversion du socialisme scientifique en religion d’une nouvelle classe ascendante la trahison de la pensée du père fondateur par des héritiers plus ou moins légitimes. Marx lui-même, en effet, aurait contribué à établir cette mystification, en particulier en occultant – pour la légitimer – l’origine de la rémunération des « travailleurs intellectuels » : le produit non payé du labeur des prolétaires. C’est pour obtenir une plus grande part de la plus-value qui leur est extorquée que « l’armée des “mercenaires” privilégiés du capital et de l’État capitaliste se trouve en opposition avec ces derniers à l’occasion de la vente de ses connaissances, et agit, pour cette raison, à certains moments de la lutte, comme détachement socialiste de l’armée prolétarienne anticapitaliste ».
Plus clairvoyant que les idéologues, dont les diverses interprétations du « phénomène stalinien » devaient fleurir par la suite dans le champ de la théorie marxiste, Makhaïski a vite découvert ce qui demeure encore opaque aux yeux de ces derniers : « L’absence de propriété privée des moyens de production ne résout en rien la question de l’exploitation, même si on appelle cet état de fait, dans un contexte différent, une “production socialisée”. » Et ce n’est pas pour rien qu’il appelle la masse ouvrière à se soulever de nouveau pour ses « exigences précises de classe » contre la « bourgeoisie démocratique d’État ». Qu’il utilise l’expression de « socialisme d’État » au lieu de celle de « capitalisme d’État » pour caractériser cette « ère nouvelle de la domination de classe des travailleurs intellectuels » n’a, sous cet angle, qu’une importance secondaire, sauf pour ceux qui aiment à ne considérer que les mots pour ne pas avoir à envisager les choses.
Il va de soi que, pour l’intelligentsia, l’État « socialiste », ce ne peut être qu’elle. Mais il fallait aussi convaincre les masses que c’était le leur. La « science marxiste » va servir à poser un signe d’égalité entre le rôle dirigeant de la classe ouvrière et celui de ses dirigeants. Ainsi les prétentions de l’intelligentsia révolutionnaire seront-elles sublimées en « mission historique » du prolétariat dont elle aura épousé la cause, non sans avoir introduit « de l’extérieur », au cas où il en aurait douté, la « conscience politique » qui lui manquait. Cet accouplement tératologique va accoucher d’un monstre : le Parti-État qui, pour aider la classe ouvrière à accomplir sa fameuse « mission », « s’appuiera » sur elle au point de l’écraser.
Ainsi s’explique la réceptivité des intellectuels à l’égard du marxisme : exaltés à l’idée de faire enfin plein usage de leurs compétences, une fois délivrés de l’humiliant contrôle des propriétaires, des industriels et des banquiers « privés », ils saluent dans l’avènement du « socialisme » l’avènement de leur propre transcendance. Quant au prolétariat, réduit par les soins des théoriciens à une abstraction historico-philosophique, il ne lui restera plus qu’à développer, contre ses « représentants », son mouvement spontané pour l’autodétermination. Mais pour que son auto-activité ne soit pas que défensive, il lui faut préserver une autonomie de pensée sans cesse remise en cause par une intelligentsia qui, non contente de le priver des produits de son travail, le prive aussi de son identité sociale, beaucoup plus efficacement que peut le faire la bourgeoisie. Car le fait que, pour la première fois dans l’histoire, l’intelligentsia soit en train de devenir une classe dominante est lourd de conséquences. En empêchant la formation d’intellectuels organiques des classes opprimées et le développement d’une vision du monde qui leur serait propre, le règne de l’intelligentsia ne rend-t-il pas problématique la saisie de la réalité sociale autrement que dans les termes de l’idéologie dominante ?
Aussi faut-il souligner que l’autoconnaissance de la société est menacée de crise dès lors que le groupe social qui, normalement, assure la production, le maintien et la transmission de la culture et des finalités sociales, s’organise en une classe dont l’activité cognitive est subordonnée à ses propres intérêts de classe.
vendredi 14 octobre 2011
Les échanges culturels en Méditerranée
L’exemple de l’optique (Alliage n° 63)
La Méditerranée est, depuis des millénaires, un lieu d’échanges entre toutes les civilisations de l’Ancien Monde, celles qui encerclent ses rives, et celles qui s’en éloignent. C’est ce que je voudrais brièvement illustrer à partir de l’histoire d’une discipline scientifique : l’optique.
Une histoire sans point fixe
Plaçons-nous d’abord dans la situation de l’historien qui, de nos jours, veut écrire l’histoire de sa discipline à l’une ou l’autre de ses étapes. Si, par exemple, il entend étudier les débuts de l’optique hellénistique, il ne manquera pas de rencontrer l’œuvre de Dioclès, du deuxième siècle avant notre ère. Sa recherche exigera donc l’examen de la compilation arabe de cette œuvre, seule à avoir survécu ; le grec n’existe plus. Si, maintenant, il s’attache à une période plus tardive de l’optique hellénistique, il devra consacrer la majeure partie de ses efforts à l’étude de la contribution capitale attribuée à Ptolémée (iie siècle). Il lui faudra cette fois se satisfaire de la traduction latine faite au xiie siècle par l’émir Eugène de Sicile, à partir de la version arabe, elle-même établie à partir du texte grec, au ixe siècle : en effet, les deux textes, grec et arabe, sont perdus. Supposons enfin que notre historien ne s’intéresse qu’à la seule optique arabe, et qu’il soit suffisamment désinvolte pour négliger les sources grecques et les traductions arabes de celles-ci, il ne pourra cependant pas faire l’économie des traductions latines et hébraïques issues de l’arabe. Nous savons que l’un des premiers travaux en optique arabe est du philosophe al-Kindi. De son livre sur l’optique, il ne nous reste que la traduction latine, qui fut une référence essentielle aussi bien pour Roger Bacon que pour John Pecham et pour Robert Grosseteste. Mais s’il étudie un chapitre particulier de l’optique arabe, comme celui des phénomènes atmosphériques, il rencontrera inévitablement le livre de l’Andalou Ibn Mu’adh, De Crepusculis, qui n’existe que dans ses traductions latine et hébraïque ; le texte arabe est perdu.
Il serait facile de multiplier de tels exemples, qui tous concourent à montrer que nous sommes bien là face à une situation spécifique, comme dans le temps dans l’espace. Si, en effet, on le compare à l’historien de l’optique d’une époque plus tardive, telle le xviiie siècle, ou à un historien de l’optique dans une autre aire culturelle — la Chine, par exemple, l’historien des sciences et des mathématiques dans les cultures méditerranéennes, jusqu’au xviie siècle, doit suivre une démarche plus contournée. Il lui faut sans répit parcourir tous les lieux ; jamais il ne peut s’appuyer sur un point fixe ; il doit rejeter, au risque de manquer totalement son objet, toute tentation de culturo-centrisme et d’histoire linéaire. Mais cette condition, propre à notre historien, n’est, en fait, que le reflet des méandres de la constitution et de la diffusion de l’optique elle-même. Arrêtons-nous donc à l’élaboration de cette science, et, au lieu des recherches de l’historien d’aujourd’hui, considérons le parcours du savant d’hier.
Libellés :
anthropologie,
articulation,
capital culturel,
contamination,
culture,
diffusion,
Méditerrannée,
science,
SE CULTURER
lundi 26 septembre 2011
Alain BROSSAT: le Grand Dégoût Culturel
jeudi 22 septembre 2011
Diatribe contre la paraplégie scolaire
L’école est-elle vraiment synonyme d’épanouissement, d’égalité des chances et d’accès à de meilleures conditions d’existence ?
N’est-elle pas aussi le lieu où la hiérarchisation sociale se met en place. Le lieu où les enfants apprennent le rôle qu’ils devront jouer dans la société industrielle et le respect de l’expert ?
L’école, l’éducation nationale, est une branche, une racine du vivre-ensemble : elle est nécessairement capitaliste :
Elle apprend que plus on passe de temps à l’école plus on vaut sur le marché, faisant ainsi du savoir un bien, qui comme tous les biens est mis sur le marché, et donc soumis à rareté. Pire, elle forme des cohortes de consommateurs dociles révérant l’expert et donc incapables d’oser encore penser et agir par eux-mêmes. C’est la croissance industrielle elle-même, dit Ivan Illich, qui conduit l’éducation à exercer le contrôle social indispensable à un usage efficient d’un produit, en vue de la croissance, et ainsi de suite. La boucle est boulée. Voila pourquoi nous dit-il, la première tâche d’un révolutionnaire serait de dé-scolariser la société.
L’éducation est capitaliste, c’est normal : il faut bien que l’usine à gaz continue de fonctionner.
N’est-elle pas aussi le lieu où la hiérarchisation sociale se met en place. Le lieu où les enfants apprennent le rôle qu’ils devront jouer dans la société industrielle et le respect de l’expert ?
L’école, l’éducation nationale, est une branche, une racine du vivre-ensemble : elle est nécessairement capitaliste :
Elle apprend que plus on passe de temps à l’école plus on vaut sur le marché, faisant ainsi du savoir un bien, qui comme tous les biens est mis sur le marché, et donc soumis à rareté. Pire, elle forme des cohortes de consommateurs dociles révérant l’expert et donc incapables d’oser encore penser et agir par eux-mêmes. C’est la croissance industrielle elle-même, dit Ivan Illich, qui conduit l’éducation à exercer le contrôle social indispensable à un usage efficient d’un produit, en vue de la croissance, et ainsi de suite. La boucle est boulée. Voila pourquoi nous dit-il, la première tâche d’un révolutionnaire serait de dé-scolariser la société.
Libellés :
capital culturel,
conformisme,
Ivan Illich,
paraplégie scolaire,
police de proximité
lundi 19 septembre 2011
"Cogitamus" de Bruno Latour (recension)
Dans sa derniére livraison, "Cogitamus, six letttres sur les humanités
scientifiques", Bruno Latour nous livre une de ses tentatives
successives de "vulgarisation" de sa pensée (comme dans "la science en
action", "petites leçons de sociologie des sciences", etc) Mais si les
autres textes ouvraient le champ des possibles vers de nouvelles
conception de la sociologie des sciences (et des techniques) celle ci
semble opérer un replis sur "l'analyse de controverses" qu'il prolonge
par la cartographie de ces mêmes controverses.
On le sait, il y a pour l'auteur la "science en train de se faire", et la science faite, la science "dépliée" (problématique et problématisée) et la science faite pour laquelle la "Nature" est une "essence" de nature fortement idéaliste. La vérité de la science se situerait du coté de la science "dépliée", de ses questionnements et de ses querelles. Les débats fortement controversé feraient apparaitre selon l'auteur qu'il n'y a pas de science "pure" ou de "science appliquée", mais des "imbroglio de sciences" ou sont mélangés science à proprement parler, mais aussi politique, sociologie, pouvoirs, institutions, instruments, tout ceci saisi dans un "noeud gordien" (qu'il conviendrait, justement "de ne pas trancher.)
Ces propos ne sont pas nouveau sous la plume de Bruno Latour, mais ce qui étonne dans un premier temps (et donc interroge, pour reprendre une de ses méthodes privilégiées) c'est la forme "classique" qu'il imprime à cet ouvrage. Présenté sous forme de "lettres", celui ci utilise en effet un ensemble de moyens rhétoriques pour s'inscrire sous la forme "classique". Le premier procédé c'est évidemment la forme "diariste" dont on a pu remarquer depuis une certaine querelle instillée par notre hyperprésident (qui s'étonnait de l'usage des "lettres de madame de Sévignée" dans la selection des fonctionnaires territorial) l'usage "subversif" qui peut en être fait. Le second entraine la réévaluation des "humanités" dans son sens "classique" mais étendu à une réflexion sur la science (le nouvel enseignement de Bruno Latour à Science Po paris étant intitulé "humanités scientifiques") Les lettres ainsi écrites s'adressent à une étudiante allemande, étudiant à paris via sans doute le programme d'échange européen "Erasmus"... (encore un humaniste, ce qui renvoit aux humanités) Enfin, le "personnage" principal de l'ouvrage semble bien être Descartes et son "Cogito ergo sum" auquel Latour opose son "nous pensons" (Cogitarum "nous pensons", oposé à la version individuelle et analytique de Descartes)
Mais tout en donnant des indices de classissisme, la matiére enseignée est bien ces "sciences studies" qui sont en France combattues et décriée en fonction d'un positivisme obsolète. Bien que l'ouvrage regorge d'exemples "nationaux", c'est bien les références anglo saxonnes qui sont alors convoquées et qui donnent aux exemples pratiques leur saveur... Il n'est besoin, pour s'en convaincre, que de lire l'abondande bibliographie en fin du livre.
On peut alors interpréter ce recours stylistique au "classique" une tactique faite pour échapper à la "science war" qui prend Latour pour cible a partir d'un fort médiocre ouvrage de Sokal et Bricmond "impostures intelectuelles". Mais aussi rassurer les "décideurs", et se mettre dans une position stratégique...
Les humanités scientifiques
Un des modèles, un des inspirateurs de Bruno Latour est, on le sait, Michel Serres. Celui ci, dans son "passage du nord ouest" livre une définition canonique de ce que sont les fameuses "humanités scientifiques" :« Deux cultures se juxtaposent, deux groupes, deux collectivités, deux familles de langues. Ceux qui furent formés aux sciences dès leur enfance ont coutume d’exclure de leur pensée, de leur vie, de leurs actions communes, ce qui peut ressembler à l’histoire et aux arts, aux œuvres de langue, aux œuvres de temps. Instruits incultes, ils sont formés à oublier les hommes, leurs rapports, leurs douleurs, la mortalité. Ceux qui furent formés aux lettres dès leur enfance sont jetés dans ce qu’on est convenu de nommer les sciences humaines, où ils perdent à jamais le monde : œuvres sans arbre ni mer, sans nuage ni terre, sauf dans les rêves ou dans les dictionnaires. Cultivés ignorants, ils se consacrent aux chamailles sans objet, ils n’ont jamais connu que des enjeux, des fétiches ou des marchandises. » Et il tente de rassembler ces deux humanités sous le même chapiteau, qui constitue justement le projet final des "humanités scientifiques".« Je crains que ces deux groupes ne se livrent combat que pour des possessions depuis longtemps raflées par un troisième, parasite, ignorant et inculte à la fois, qui les ordonne et qui les administre, qui jouit de leur division et qui la nourrit » Pour rassembler ces deux groupes, l'épreuve privilégiée qui permet de rassembler ces deux brins épars des "humanités" classique, c'est l'analyse de controverse. En analysant les polémiques mettant en bout des "morceaux de science", des bouts de politiques, des humeurs, des institutions, cela permet de rendre le réseau de leur relations plus visible (B Latour donne l'exemple de l'explosion de la navette "Challenger" comme exemple canonique du passage à un système technique "simple", à un systéme faisant ressortir les alliances, les stratégies, les mélanges....)Contre Descartes
A l'inverse de Paul Feyerabend, auteur d'un "contre la méthode", ce n'est pas le coté analytique et rationaliste de Descarte que Bruno Latour prétend contester, mais son célébre "Cogito Ergo Sum" ("je pense, donc je suis") Pour Latour, on ne pense jamais seul, "hors sol"... Il ne se situe pas non plus dans la mouvance des "savoirs situés" chers à Donna Haraway (qui mériterait, le concept et son auteur, un billet à lui tout seul) mais dans une conception chorale des imbroglios de science, de culture, de politique et de rhétorique... Cette conception "orchestrale" de la science correspond de plus en plus à l'activité réelle du chercheur, qui est de moins en moins un esprit seul dans son laboratoire, révolutionnant le savoir avec des expériences presques clandestines (pour autant que cette description ne soit pas en réalité une réécriture de fiction), mais dans un processus de plus en plus complexe de références et d'échanges, de citations réciproques et de dispositifs techniques lourds industrialisés (un accelérateur de particule ne ressemble t il pas de plus en plus à une usine ?)Philosophie des sciences : les cosmos
Une autre notion disputée dans cet ouvrage comme dans l'oeuvre de Bruno Latour est celle de la négation de la "révolution scientifique" comme récit hagiographique trompeur, la sainteté de la Science étant destinée à remplacer les vieilles doctrines religieuses (c'était, on se le rappelle, le projet politique d'Auguste Comte, celui de remplacer le christianisme par la science positive) Cette notion est bordée par la notion de "cosmos" auquel se serait substituée la notion d'univers : grâce à la "révolution scientifique et technique", le cosmos borné des ancêtres religieux, confondant allègrement les opinions et les faits serait remplacé par un "univers" sans véritable limite. Cela ferait des opinons et des religions un reste désormais sans objet : illusion dangereuse, nous averti l'auteur ! D'autant que la réalité contemporaine utilise plutot la notion de "multivers", mis en exergue par Hugh Everett. Et que la multiplicité des mondes ainsi recréée fait un retour paradoxal à l'antique cosmos par une de ces ruses dont l'histoire est parait il friande...Cartographie des controverses : du concept aux solutions techniques
Mais l'ouvrage n'est absoluement pas dénuée de visée pratique. La science et les techniques sont aujourd'hui menacées, contestées, discutées et disputées. Les OGM ne sont ils bon qu'a l'enrichissement des firmes semancières et à la vanité de quelques sommitées ayant remplacé le labo par le studio de télévision ? Les nano technologies ne sont elles pas un péril pour la liberté individuelle et pour la santé publique ? Enfin, "the last but not least", le réchauffement climatique n'est il pas l'exemple d'une querelle scientifique et politique impossible ? Face à la montée des contestations, Bruno Latour lui même ne cache pas sa perplexité. Et il propose de prolonger la classique "analyse de controverse" (qu'il pratique depuis plus de 20 ans) par une "cartographie des controverses" qui permet à partir d'éléments nouveaux (outils maintenant disponible sur Internet) de décrire finement tous les développements, tous les détours, toutes les compositions d'un probléme "scientifique, technique, politique, humain". Partant du constat d'une crise d'autorité du modéle qui confie à des "Experts" la mainmise sur ces problémes complexes , il entend proposer des outils simples et efficaces pour dérouler l'écheveau complexe des causes et des effets, des intérêts et des passions.Mais ces outils ne semblent pas non plus d'une efficacité prouvée. Certes, il permettent de mieux comprendre les différents tenants d'un problème, mais non de pouvoir "trancher le noeud gordien". Puisqu'il faut bien qu'à un moment ou à un autre, le lien soit tranché....
Source : Marc TERTRE/MEDIAPART
mercredi 10 août 2011
SORAL - LES PETITES GENS
Libellés :
Alain SORAL,
capital culturel,
culture,
éprouver,
expérience,
intellectuel,
manuel,
MATERIA,
prolétariat
mardi 24 mai 2011
SITUATION DE TRANSHUMANCE (REFLEXIVITÉ)
Lors du creusement de la route Transamazonienne au Brésil dans les années 1970, l’Etat brésilien alors aux mains des militaires mit au point la politique dite du “contact forcé” pour contraindre les Indiens à abandonner leurs mythes, rites et croyances, condition nécessaire et suffisante de leur soumission. La technique d’approche est simple, mais d’une redoutable efficacité : on édifie des tapini, abris rudimentaires en feuillage où sont accrochés des “cadeaux”.
Quand l’Indien referme la main sur l’appât, il ne peut plus la retirer. Il est pris dans l’engrenage fatal des échanges marchands. Ainsi pris la main dans le sac, il est transféré dans un “camp d’attraction indigène” où il doit bien finir par aliéner sa liberté et se vendre au(x) nouveau(x) maîtres pendant que son village est détruit. Le processus d’acculturation est brutal, destructeur et extrêmement rapide. En quelques semaines sont détruites des milliers d’années de sociabilité dite primaire, impliquant une réciprocité fondée sur le cycle symbolique donner-recevoir-rendre mis au jour par Marcel Mauss. Dans ces camps d’attraction indigènes, les taux de suicides, individuel ou collectif, sont considérables.
Quand l’Indien referme la main sur l’appât, il ne peut plus la retirer. Il est pris dans l’engrenage fatal des échanges marchands. Ainsi pris la main dans le sac, il est transféré dans un “camp d’attraction indigène” où il doit bien finir par aliéner sa liberté et se vendre au(x) nouveau(x) maîtres pendant que son village est détruit. Le processus d’acculturation est brutal, destructeur et extrêmement rapide. En quelques semaines sont détruites des milliers d’années de sociabilité dite primaire, impliquant une réciprocité fondée sur le cycle symbolique donner-recevoir-rendre mis au jour par Marcel Mauss. Dans ces camps d’attraction indigènes, les taux de suicides, individuel ou collectif, sont considérables.
Pour attraper un Européen moyen vivant au début du XXI° siècle, c’est trés simple. Il suffit de lui montrer des objets dans une boîte appelée téléviseur. S’il flashe sur l’objet, il n’a qu’un pas à faire vers le supermarché tout proche où il se trouve. Variante : on peut aussi lui montrer l’objet dans une boîte légèrement différente appelée ordinateur. Un clic de souris suffit alors. Dans les deux cas, le résultat est le même : quand l’Européen referme la main sur l’appât, il ne peut plus la retirer. A la différence des Indiens, il est content: il croit qu’il a saisi l’objet de sa convoitise. Il ne sait pas encore qu’il est en fait attrapé par ce qu’il a saisi. Il est pris comme un petit pervers qui se fait prendre en croyant simplement jouir. Pris par ce qu’il croyait prendre. Pris en somme, par plus pervers que lui. Ainsi pris, on peut le conduire où l’on veut puisque, ayant attrapé son objet de convoitise, il se croit libre.
Cela s’appelle l’addiction.. …
Cela s’appelle l’addiction.. …
Libellés :
AUTONOMIE,
capital culturel,
consommation,
FÉTICHISME,
généalogie,
INAKOMYLIACHTCHI,
libido,
réflexivité,
voie du spectacle,
zombitude
samedi 26 février 2011
HA LLEGADO EL CARNAVAL, CHIRIGOTA YA!
Libellés :
CADIX,
capital culturel,
CARNAVAL,
farce,
happening,
humour,
picaresque,
rue,
sociologie
samedi 25 décembre 2010
DU DADAÏSME D'ÉTAT: UN OPPORTUNISME GAZEUX
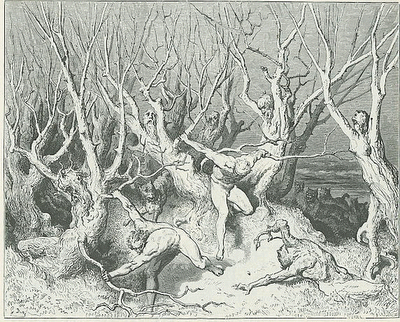
LA POLITIQUE CULTURELLE FAIT AUJOURD'HUI PARTIE DES CHAMPS D'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS. ELLE DEMEURE NÉANMOINS FLOUE DANS
AMBIVALENCE.
L'ÉMERGENCE DE LA CULTURE COMME CATÉGORIE D'INTERVENTION PUBLIQUE N'A PAS ÉTÉ UN PROCESSUS LINÉAIRE. LES PROBLÈMES
CULTURELS (TELS QUE LES CONDITIONS DE LA "CRÉATION ARTISTIQUE" OU LA "DÉMOCRATISATION CULTURELLE") ONT D'ABORD ÉTÉ CONSTRUITS CONTRE L'ÉTAT QUAND ARTISTES ET INTELLECTUELS AFFIRMAIENT LEUR
AUTONOMIE. ILS SONT DÉSORMAIS CONSTRUITS ET TRAITÉS PAR DES EXPERTS OFFICIELS ET DES ADMINISTRATEURS DE CULTURE, AU SEIN D'INSTANCES ET D'INSTITUTIONS ÉTATIQUES. EN BREF, ILS DEVIENNENT DES
PROBLÈMES D'ÉTAT.
D'UN HALO DE FLOU PROPICE À ÉLOIGNER LE SPECTRE D'UNE CULTURE D'ÉTAT ET RÉACTIVE PLUS QU'ELLE NE LES TRANCHE LES DÉBATS SUR LA DÉFINITION DE LA CULTURE.
Libellés :
capital culturel,
complexe politico-culturel,
culture,
dadaïsme,
détournement,
état,
étroits-pointus,
récupération
dimanche 21 novembre 2010
« Telle est depuis un demi-siècle l'attitude de ces hommes dont la fonction était de contrarier le réalisme des peuples et qui, de tout leur pouvoir et en pleine décision ont travaillé à l'exciter ; attitude que j'ose appeler pour cette raison la trahison des clercs. Si j'en cherche les causes, j'en aperçois de profondes et qui m'interdisent de voir dans ce mouvement une mode à laquelle pourrait succéder demain le mouvement contraire. Une de ces principales est que le monde moderne a fait du clerc un citoyen soumis à toutes les charges qui s'attachent à ce titre, et lui a rendu par là beaucoup plus difficile qu'à ses aînés le mépris des passions laïques. A qui lui reprochera de n'avoir plus, en face des querelles nationales, la belle sérénité d'un Descartes ou d'un Goethe, le clerc pourra répondre que sa nation lui met un sac sur le dos si elle est insultée, l'écrase d'impôts si elle est victorieuse, que force lui est d'avoir à cœur qu'elle soit puissante et respectée; à qui lui fera honte de ne point s'élever au-dessus des haines sociales, il représentera que le temps des mécénats est passé, qu'il lui faut trouver aujourd'hui sa subsistance et que ce n'est pas sa faute s'il se passionne pour le maintien de la classe qui se plaît à ses produits. »
Julien Benda, La trahison des clercs - 1927
Libellés :
bourgeoisie,
capital culturel,
cléricature,
trahison
lundi 25 octobre 2010
LES BOBOS, CRITIQUE D'UN FAUX CONCEPT
REVUE DE LIVRE: David BROOKS, 2000, Les Bobos, Les bourgeois bohèmes
SOURCE: Anne Clerval URL : http://cybergeo.revues.org/index766.html.
L’expression “bobo”, contraction de l’oxymore “bourgeois bohème”, est couramment employée en France depuis quelques années. Elle désigne une catégorie assez floue de personnes, qui se distingueraient essentiellement par leurs choix de consommation, que ce soit pour la décoration de leur logement, leur alimentation ou leurs loisirs. Au-delà de l’anecdote médiatique que cela représente, on est inévitablement confronté à ce terme envahissant quand on étudie la gentrification, ce type particulier d’embourgeoisement qui concerne les espaces urbains traditionnellement populaires et s’accompagne de la réhabilitation de leurs logements. Ceux qui s’approprient ces logements, les gentrifieurs, correspondent principalement à ceux que l’on désigne comme “bobos”. Résider dans ces quartiers centraux réhabilités est presque devenu un critère d’appartenance à cette catégorie de personnes.
2Là où les chercheurs en sciences sociales parlent de gentrifieurs, les journalistes parlent de bobos. Est-il possible de réconcilier ces deux notions ? Et faut-il le faire ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de revenir à l’origine de l’expression, c’est-à-dire au livre d’un journaliste américain, David Brooks, intituléBobos in Paradise, publié en 2000 aux États-Unis et immédiatement traduit en français (Brooks, 2000). Cet ouvrage, traitant d’un objet sociologique, n’est pourtant qu’un essai et ne répond à aucun critère scientifique. Mais le ton est affirmatif et a convaincu bien des journalistes et, à travers eux, le citoyen lambda, de l’existence de ce nouveau groupe social atypique qui signerait la disparition des distinctions de classe.
3La critique qui suit est autant celle de l’ouvrage que de sa portée, de l’étonnante véracité qu’on lui accorde. Cet effet de réalité, amplifié par les médias, complique l’étude de la gentrification et en particulier de ses acteurs. La thèse de la synthèse entre bourgeoisie et bohème développée par D. Brooks peut être critiquée sur la forme et sur le fond. Plus qu’une hypothétique disparition des classes, il s’agit plutôt de l’émergence d’un nouveau groupe social, dont la réalité sociale reste à préciser.
La thèse : une synthèse entre bourgeoisie et bohème
4La thèse de D. Brooks est celle d’une réconciliation entre les contraires, plus précisément la synthèse de deux groupes sociaux, les bourgeois et les bohèmes, en un seul. Après la farouche opposition, dans l’Amérique des années 1960, d’une élite sociale bourgeoise conservatrice et d’une jeunesse bohème progressiste, ces deux pôles auraient fusionné dans les années 1990-2000. Les bourgeois des années 1950-1960 fondaient leur pouvoir sur l’héritage, un peu à la façon de l’aristocratie européenne de l’Ancien Régime, et défendaient l’ordre établi des WASP. Les bohèmes de la même époque remettaient profondément en cause cet ordre établi et la fermeture de cette élite. Dans les années 1990-2000, une nouvelle élite est apparue, trouvant sa légitimité dans le mérite universitaire et travaillant dans le vaste domaine de la création qui va de l’artiste et du chercheur au publicitaire en passant par la gestion des ressources humaines, réinventant sans cesse l’entreprise. Elle constitue un nouvel establishment fondé sur une partie des valeurs portées par la contestation des années 1960 : la culture sous toutes ses formes, la tolérance et l’ouverture aux minorités ethniques ou sexuelles, l’écologie et l’émancipation sexuelle, voire la critique de l’autorité. Cette nouvelle élite est, malgré tout, la prolongation des yuppies des années 1980, jeunes cadres dynamiques avides de réussite, pour lesquels l’argent est tout sauf un tabou.
5Après avoir décrit l’ascension sociale de cette nouvelle élite, appelée “socioculturelle”, essentiellement fondée sur les diplômes d’universités prestigieuses et liée à la mise en place de la ”nouvelle économie” fondée sur l’information, D. Brooks décline toutes les facettes de son mode de vie : consommation, travail, vie intellectuelle, plaisir, vie spirituelle et politique, les derniers chapitres étant les plus courts. Chaque volet de ce mode de vie est l’illustration de la synthèse jugée réussie entre richesse et valeurs de la contre-culture.
Critique de la méthode
6Avant toute critique du fond, il faut rappeler que cet ouvrage n’est pas le fruit d’une démarche scientifique. Dès l’introduction, l’auteur prévient que son livre contient « peu de statistiques. Peu de théorie. [et que] Max Weber peut dormir sur ses deux oreilles. » (p. 15-16) et il précise qu’il fait partie de ce groupe qu’il va décrire et qu’il s’érige en « défenseur de la culture Bobo » (p. 16). Cet ouvrage n’est donc qu’un essai ne prétendant à aucune scientificité malgré les apparences, et se l’interdisant d’emblée en revendiquant sa subjectivité et sa partialité.
7Les affirmations de l’auteur ne s’appuient sur aucune source extérieure aux observations de son auteur, qui plus est non objectivées : aucune donnée statistique, aucune enquête de terrain digne de ce nom, respectant les critères de scientificité reconnus par les sciences sociales.
8Les concepts sociologiques utilisés par l’auteur ne sont ni définis ni précisés. C’est le cas de la lutte des classes, des classes sociales en général, des bourgeois en particulier, et plus encore de notions extrêmement floues comme “les” bohèmes. Cela invalide largement la thèse de l’émergence d’une nouvelle classe sociale dominante, puisque rien ne permet d’en mesurer l’étendue et le pouvoir réels, notamment en la replaçant dans le contexte social général. Les classes moyennes ne sont qu’à peine évoquées et les classes populaires sont remarquablement absentes, cette absence étant loin d’être anodine.
9En soi, cet essai est exemplaire de l’idéologie que décrit Brooks : les affirmations péremptoires, les descriptions hautes en couleurs et le style familier sont censés remplacer une argumentation s’appuyant sur des preuves. Comme dans tant d’autres succès de librairie, cet essai s’adresse au lecteur par la séduction de son propos, d’autant plus facile qu’il abonde dans le sens de l’idéologie dominante.
Critique de l’analyse : la réalité d’une telle réconciliation des contraires
10Outre son absence de fondement scientifique, cette thèse comporte deux biais majeurs qui font d’elle une idéologie au sens marxien du terme : une idée fausse destinée à justifier l’ordre établi. Le premier concerne la réalité de cette synthèse prétendue entre bourgeoisie et contestation, le second la question des classes sociales et de leur hypothétique disparition.
11Qu’en est-il de ce mariage entre bourgeoisie et bohème ? Avant d’examiner ce qu’il en est réellement, il faut préciser que bourgeoisie et bohème ne renvoient pas à des objets équivalents, comme le présuppose D. Brooks. En effet, la bourgeoisie est un groupe social bien identifié, situé au sommet de l’échelle sociale des sociétés modernes, cumulant pouvoir économique, pouvoir politique et pouvoir culturel. Elle peut prendre des formes différentes et suivre des modes variables, son rôle est toujours le même et, la plupart du temps, elle défend un ordre établi qui garantit son pouvoir et les valeurs qui vont avec, celles-ci pouvant varier selon les époques et les pays.
12En revanche, la bohème désigne un ensemble bien moins cohérent et daté historiquement de personnes ayant en commun la contestation de l’ordre bourgeois. À l’origine, ceux qui s’en revendiquèrent étaient des artistes français du XIX e siècle comme Nerval ou Rimbaud, eux-mêmes fils de bourgeois en rupture de ban, tant par leur parti pris esthétique que par leur mode de vie, voire par leurs idées politiques, le tout étant intimement lié. La bohème renvoie à une vie marginale, sans argent et parfois sans toit, qui était le lot de ces artistes d’abord non reconnus, notamment parce qu’ils critiquaient ouvertement les valeurs bourgeoises. D. Brooks désigne par le même terme la jeunesse contestataire des années 1960 aux Etats-Unis(1) : cette fois, il s’agissait d’étudiants, la plupart du temps issus des classes moyennes, qui s’engageaient dans la lutte politique contre la guerre du Vietnam ou contre la société de consommation, et expérimentaient des modes de vie communautaires alliant entre autres écologie et liberté sexuelle. Leur refus du système politique et économique se traduisait aussi par une vie relativement marginale, même si c’était souvent passager.
13Bourgeoisie et bohème désignent donc deux ensembles de valeurs antinomiques, apparemment inconciliables. Ceux que D. Brooks désigne comme “bobos” correspondent, la plupart du temps, à d’anciens étudiants contestataires ayant maintenant un statut social et un niveau de vie équivalent des bourgeois qu’ils moquaient jadis. D. Brooks prétend qu’ils ont pu progresser socialement sans dénaturer leurs idéaux. Or, tout son livre démontre l’inverse : les “bobos”, qu’ils soient d’anciens “bohèmes” devenus bourgeois ou des bourgeois adoptant les modes “bohèmes”, recyclent les mots d’ordre contestataires des années soixante en les vidant de leur sens. Le souci de l’écologie et de l’authentique sert de prétexte à de nouvelles modes de consommation pour des produits aussi coûteux que ceux qu’affectionnait la bourgeoisie traditionnelle. Au lieu de se ruiner pour des bijoux, les “bobos” vont le faire pour une cuisine. L’objet a changé, sous l’influence de la contestation des années soixante, mais la démarche est la même. La société de consommation n’est pas remise en cause, seul le décor a changé. De même, la critique de l’autorité débouche sur une nouvelle organisation de l’entreprise, où l’on travaille plus volontiers en équipe, où les rapports se doivent d’être amicaux. Cela est facilité par le fait que ces entreprises, comme celles de l’information ou des nouvelles technologies, emploient essentiellement des salariés de même niveau social. Ce qui était jadis le refus de l’aliénation du travail devient l’exigence d’avoir un travail épanouissant, qui mérite qu’on lui consacre dix à douze heures par jour. « Le travail devient donc une vocation, un métier. Et ce qui est étrange, c’est que dès que les employés se mettent à penser comme des artistes et des militants, ils travaillent en fait plus dur pour l’entreprise » (p. 148). Toutes les anciennes transgressions se voulant subversives deviennent des objets de consommation, que ce soient le sadomasochisme, qui se vend sur Internet, l’écologie ou la contestation elle-même, devenue une inépuisable source de slogans pour les publicitaires.
14Quand D. Brooks cite Thomas Frank, rédacteur en chef d’un magazine, le Baffler, qui « se moque des pseudo-transgressions de la classe d’affaires et de toutes leurs déviances socialement acceptées. Thomas Frank prétend qu’en fait, tout cela n’est qu’une autre forme de conformité conservatrice » (p. 128), il le réfute au motif de l’honnêteté des bobos dans l’expression de leurs valeurs bohèmes. Une fois de plus, l’analyse sociologique est déplacée sur le terrain moral et idéologique. Pourtant lui-même, tout en louant le plus souvent la réussite de cette synthèse, reconnaît que les bobos “penchent” plus du côté bourgeois que bohème : leur refus du conformisme bourgeois traditionnel devient très vite un nouveau conformisme, qu’ils défendent de la même façon, comme une garantie de leur domination culturelle. « Au niveau de l’humour, par exemple, nous tolérons les plaisanteries à caractère sexuel mais nous sommes extrêmement intolérants en ce qui concerne les blagues racistes. Nous sommes beaucoup plus relax au niveau du maintien et de l’habillement, mais en contrepartie beaucoup plus restrictifs vis-à-vis des éclats de colère en public, des crachats et de la cigarette » (p. 216) … on est loin des pratiques bohèmes de la subversion. Tout se passe comme si le code bourgeois était seulement déplacé : le moine a seulement changé d’habit. Même la morale est toujours autant mise en avant, mais au motif d’une préoccupation maladive pour la santé physique : les drogues, par exemple, ne sont pas rejetées pour des raisons morales condamnant la licence et la recherche du plaisir, mais parce qu’elle nuisent à la santé. L’interdit n’en est que plus redoutable. Dans la recherche du plaisir elle-même, sexuel et plus généralement physique, les bobos mettent l’application et le perfectionnisme d’un séminariste : « Les Bobos ne se contentent pas de rendre moral ce qui fut autrefois subversif. Ce sont des adeptes du mérite de A à Z. Il ne leur suffit pas d’avoir un orgasme, ils accomplissent un orgasme […] Le sexe ne se limite pas à une partie de rigolade sous la couette. Il faut que ce soit quelque chose de puissant, qui incite à la réflexion. Quelque chose de sain, raisonnable et socialement constructif. On peut affirmer sans crainte que l’hédonisme n’est plus ce qu’il était. » (p. 210-212). D. Brooks souligne lui-même la confusion entre travail et plaisir : « pour les Bobos, le travail n’est pas une notion péjorative. C’est simulant et intéressant. C’est sans doute ce qui fait que leurs loisirs ressemblent à s’y méprendre à du travail. » (p. 223)… on ne voit plus très bien ce qu’il y a de bohème là-dedans.
15Finalement, cette prétendue réconciliation entre bourgeoisie et bohème apparaît bien plus comme la récupération bourgeoise de certaines idées bohèmes, notamment par le biais essentiel de la consommation, une sorte de changement d’apparence des pratiques bourgeoises. Les bobos ont tout de la bourgeoisie, à commencer par le niveau social et le capital culturel, mais le sont différemment de la bourgeoisie traditionnelle : ils habitent des logements luxueux, mais ils préfèrent les centres historiques aux banlieues résidentielles, ils privilégient le confort, mais la norme en a changé, passant de logements aux multiples pièces à de vastes lofts aux espaces ouverts, ils dépensent beaucoup, tant grâce à un pouvoir d’achat élevé que pour se distinguer des autres groupes sociaux, et cette distinction passe par de nouveaux objets, un grille-pain au dessin imitant ceux des années 1960 au lieu d’un collier de perles par exemple, et ainsi de suite.
L’idéologie de la disparition des classes
16Pourtant, D. Brooks refuse de voir les bobos comme une nouvelle bourgeoisie… au contraire, ils signent selon lui la fin des distinctions de classe. Ayant conçu ce livre à son retour aux États-Unis, après plusieurs années passées en Europe, il écrit dès l’introduction : « Ce qui m’a le plus frappé – et qui était le plus étrange – c’est que les anciennes classes ne veulent plus rien dire » (p. 13). Or, si bourgeoisie et bohème sont antinomiques sur le plan idéologique, ce n’est pas le cas sur le plan social, les bohèmes étant souvent issus de la bourgeoisie, même petite. Et ces deux termes sont loin de contenir l’ensemble de la société, les classes moyennes et surtout les classes populaires leur échappant totalement. Ainsi, même s’il était possible qu’une bourgeoisie adopte les valeurs bohèmes, cela ne conduirait pas pour autant à l’effacement des classes sociales. Et D. Brooks évite soigneusement de parler des classes populaires : nulle mention, dans son livre, des travailleurs pauvres ou des minorités ethniques, si ce n’est dans une note en bas de page dans laquelle il remet en cause la politique de discrimination positive (p. 286). Ce faisant, l’image qu’il donne de la réalité sociale est tellement déformée qu’il peut qualifier de « maigre » le salaire annuel de 105 000 $ d’une intellectuelle fictive(2) (p. 198), alors que le revenu annuel moyen des ménages américains dépasse à peine les 48 000 $ et que près de 13% des ménages (soit plus de 36 M de personnes) ont un revenu annuel inférieur au seuil de pauvreté (9 500 $ pour une personne seule, 18 600 $ pour une famille de quatre personnes).
17Quel peut-être le but d’une argumentation aussi fragile ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur le dernier chapitre, consacré à la politique. Ce chapitre consiste en une apologie en règle de la troisième gauche, représentée ici par Bill Clinton, dont le génie aurait été, comme celui du bobo, de réconcilier les contraires. « Ils cherchent à se frayer un chemin sur la voie du milieu, entre la gauche et la droite traditionnelles. Ils trouvent des étiquettes conciliatrices comme le conservatisme compatissant, l’idéalisme pratique, le développement tolérable, la croissance intelligente et la prospérité objective. […] l’administration Clinton/Gore a donné corps à cet esprit de compromis qui est au cœur de l’entreprise Bobo » (p.285). Le parallélisme ne s’arrête pas là : comme la réconciliation supposée de la bourgeoisie et de la bohème était présentée comme la fin de la lutte des classes, la prétendue réconciliation par cette troisième gauche des valeurs conservatrices et progressistes est présentée comme la fin des idéologies. Mais son électorat bobo est désormais présenté comme une nouvelle classe dominante : « l’Amérique compte aujourd’hui 9 millions de foyers dont le revenu annuel dépasse 100 000 $, c’est la tranche de la population la plus active. Et cette nouvelle classe dirigeante qui exerce son hégémonie sur les deux partis politiques américains a fait en sorte d’arrondir les angles de l’idéologie et de tempérer la ferveur doctrinale.(3) » (p.288). La politique de la troisième gauche est même qualifiée d’ « anti-idéologique » (p.287). Le juste milieu, valeur bourgeoise par excellence, se présente avec la force de la vérité, tout autre position étant qualifiée d’idéologique(4).
18Or, cette politique, qui considère comme acquises les réformes néolibérales Thatcher-Reagan, se présente, tels les bobos eux-mêmes, comme avant tout conservatrice. Il s’agit avant tout de restaurer l’autorité et le contrôle social, à travers le cadre local, ce que D. Brooks appelle l’ « autorité intime » (p.295). Celle-ci est liée à la communauté, élément fondateur du système politique américain, et présentée comme « moins idéologique » (p. 296) qu’une autorité institutionnelle lointaine, en somme une nouvelle forme de paternalisme : « L’autorité intime est impartie, pas imposée. C’est le genre de pression constante et douce exercée par des parents aimants ou par l’entourage » (p.296), une sorte de totalitarisme doux : « [C’est] une autorité qui se situe sur un plan biologique : tous les membres d’un écosystème exercent une pression graduelle et subtile sur les autres de manière à ce que toute la chaîne puisse fonctionner. » (p.297). Parmi les projets politiques promus par les bobos à l’échelle locale, on ne trouve pas moins que les communautés fermées et l’urbanisme sécuritaire : « Si vous allez dans un quartier Bobo, vous y trouverez forcément une puissante association de citoyens qui milite en faveur de zones où ne résident que des personnes répondant à des critères socio-économiques très élevés et dont l’accès est surveillé jour et nuit » (p.294), cela étant associé à la sauvegarde des quartiers anciens ; « Ou encore par des projets résidentiels dans la lignée du mouvement pour un Nouvel Urbanisme, qui sont conçus pour que les gens puissent toujours se surveiller entre eux dans la rue, une façon subtile de faire respecter les standards de comportement et de bienséance au sein d’une communauté. » (p.297).
19D. Brooks reconnaît que les bobos sont devenus conservateurs, ne serait-ce que pour maintenir cet ordre du monde dans lequel ils dominent. « Ce sont ces Bobos qui définissent notre ère, écrit-il dans l’introduction. Ce sont eux, le nouvel establishment. C’est leur culture hybride qui compose l’air que nous respirons tous. Leurs codes sociaux gouvernent aujourd’hui notre vie sociale. Leurs codes moraux structurent notre vie personnelle. » (p.15). Une fois évacué le débat économique, puisque le système néolibéral est considéré comme le seul possible, il ne reste à débattre que de questions morales. La confusion est totale dans ce passage, où D. Brooks fait montre d’une position typiquement conservatrice : « Beaucoup des problèmes économiques qui surgissaient avec la violence d’une véritable épidémie au cours des années 60 et 70 semblent en voie de guérison, même si les progrès sont irréguliers. Le taux de criminalité a baissé, tout comme celui des divorces, des avortements, de l’usage de cocaïne ou de la consommation d’alcool chez les adolescents. » (p.300). Les problèmes économiques sont réduits à des maux sociaux et surtout moraux, les divorces comme la cocaïne mis sur le même plan, et attribués, avec la métaphore de la maladie, aux mouvements contestataires des années 1960. On est loin de la valorisation des valeurs bohèmes, digérées par les bobos.
20Finalement, cet ouvrage s’inscrit pleinement dans la grande imposture proclamant la fin des idéologies pour mieux en imposer une nouvelle, dont le but est de justifier l’ordre du monde tel qu’il est, et plus précisément le tournant qu’il prend depuis les années 1990. Cela permet de cerner la charge symbolique que porte en elle l’expression apparemment anodine de “bobo”, et pourquoi il faut être prudent quant à son emploi.
Les bobos, une nouvelle bourgeoisie ?
21Pour conclure, il faut s’interroger sur le succès qu’a connu le terme de “bobo” bien au-delà des États-Unis, et notamment en France. Sans doute a-t-il été porté essentiellement par des journalistes qui partageaient la même vision politique que D. Brooks. Leur propension à peindre une société sans classe et à considérer le système économique néolibéral comme allant de soi les prédisposait à adopter avec enthousiasme cette notion de “bobo”, malgré l’absence de rigueur de son promoteur. Mais plus encore, les descriptions hautes en couleur de D. Brooks ont, malgré tout, rencontré un certain écho dans la réalité, des gens s’identifiant à cette peinture ou y reconnaissant d’autres.
22Si on a pu montrer que l’idéologie “bobo” était plus bourgeoise que bohème et que les “bobos”, s’ils existent, ne forment pas la réconciliation des deux classes antagonistes, ils peuvent toutefois correspondre à une nouvelle bourgeoisie, les chercheurs anglo-saxons parlant de new middle class (Ley, 1996). Hautement diplômée, cette nouvelle élite exercerait les postes-clés de la société informationnelle, dans les médias, la publicité et l’industrie culturelle en général, détenant de ce fait un pouvoir idéologique indéniable. Classe montante, elle serait concurrente de l’élite industrielle et financière traditionnelle, et elle s’en distinguerait et surtout contesterait son pouvoir politique et économique en se parant de l’esthétique contestataire. L’héritage contestataire, dont la portée subversive concernait l’ensemble d’un système et d’une société, serait détourné au profit d’une lutte d’influence au sommet.
23Pour asseoir réellement cette hypothèse, il faudrait mener de véritables recherches sociologiques afin d’identifier cette éventuelle nouvelle bourgeoisie et de cerner ses rapports avec la bourgeoisie traditionnelle. Il faudrait aussi prendre en compte la capacité qu’a le pouvoir médiatique aujourd’hui à modeler en partie la société. Lancé par un journaliste et porté par d’autres, le “bobo” est sans doute avant tout un modèle de consommation, construit notamment par la publicité, qui est passée maître dans la récupération des slogans révolutionnaires pour vendre les produits les plus triviaux. Mais le succès de ce modèle réside plus probablement dans sa rencontre avec l’aspiration d’un groupe social en pleine ascension auquel il sert de signe de reconnaissance et de distinction par rapport à la bourgeoisie traditionnelle, dont il est potentiellement le concurrent.
24À cet égard, la question de la gentrification, dont était partie cette note critique, joue un rôle important dans la définition de ce modèle. En effet, D. Brooks souligne l’importance qu’a eue l’ouvrage de Jane Jacobs, Déclin et survie des grandes villes américaines, publié en 1961 aux États-Unis, dans l’émergence de ces nouveaux choix de consommation, de ce nouveau mode de vie (Jacobs, 1961). Cette écrivaine critiquait la rénovation des centres urbains de l’après-guerre selon les principes modernistes de l’époque, qui entraînait la démolition des quartiers anciens, remplacés par de grands immeubles identiques et sans âme. Elle-même habitait le quartier de Greenwich Village à New-York, quartier du XVIII e siècle, aux petits immeubles et aux rues étroites, contrastant fortement avec le reste de la ville, quartier investi par les artistes et les contestataires dès la fin du XIX e siècle. Dans son livre, elle décrit la vie de quartier à Greenwich Village, l’importance des petits commerçants, les relations de voisinage, qui assurent convivialité et sécurité. Cet ouvrage a été le fer de lance de l’idéologie sur laquelle s’est appuyée la gentrification. Aujourd’hui, Greenwich Village est devenu un quartier gay à la mode aux prix immobiliers très élevés. Et les gentrifieurs, tels qu’ils sont décrits dans les écrits de Tim Butler et Garry Robson à propos de Londres, correspondent assez bien à certaines des observations de D. Brooks (Butler & Robson, 2003).
25Ainsi, la gentrification, processus spatial de différenciation sociale dans l’espace urbain, joue peut-être un rôle déterminant dans l’identification de cette nouvelle bourgeoisie montante. Pour éviter un terme aussi peu justifié que “bobo”, on préféra utiliser celui de “gentrifieurs” et, ce faisant, qualifier cette probable nouvelle bourgeoisie à travers ses choix résidentiels. Plus qu’une simple question d’adresse, ces choix sont en effet la pierre angulaire d’une stratégie de distinction sociale, voire de prise de pouvoir symbolique sur la ville.
1- Il faut préciser qu’avant eux, tout une partie de la classe ouvrière américaine a connu la bohème, c’est-à-dire l’absence de domicile fixe, à l’époque des grands chantiers ferroviaires de la fin du XIX e et du début du XX e siècle. Cette bohème sans domicile, homeless bohemia, est devenue le “Hobo” sous la plume du sociologue de l’École de Chicago Nels Anderson qui lui consacra un riche ouvrage en 1923. La ressemblance phonétique entre “hobo” et “bobo” n’est sans doute pas anodine, même si on peut se demander ce que ces deux personnages idéaux-typiques ont en commun.
2- Dans le chapitre consacré à la vie intellectuelle des bobos, D. Brooks décrit l’ascension d’une intellectuelle imaginaire : le choix d’un “créneau” porteur comme la “société civile” ou le “développement durable”, la rédaction d’articles, la publication de livres, mais surtout, la tenue de réunions-débats, de conférences et, en guise de couronnement, l’invitation sur un plateau de télévision.
4- Faut-il préciser que le célèbre ouvrage de Daniel Bell, La Fin de l’idéologie, dont la première publication date de 1960, désignait uniquement la fin de l’idéologie communiste incarnée dans le système soviétique ? Cet ouvrage apparaît singulièrement daté quand il évoque un consensus politique sur les questions socio-économiques qui a, depuis, volé en éclats : « Dans le même temps, les anciennes “contre-croyances” ont perdu aussi de leur force intellectuelle. Peu de “libéraux” classiques mettent en avant l’idée que l’État ne devrait jouer aucun rôle dans l’économie, et peu de conservateurs sérieux, du moins en Grande-Bretagne et sur le continent européen, croient que l’État-providence “conduit à l’esclavage”. Dans le monde occidental, il y a donc aujourd’hui un quasi-consensus parmi les intellectuels autour des enjeux politiques : acceptation de l’État-providence, avantage d’un pouvoir décentralisé, système mixte en économie et pluralisme politique. En ce sens, l’âge idéologique appartient au passé. » (p. 56 de l’édition française, aux PUF, 1997).
Libellés :
Anne CLERVAL,
bobos,
capital culturel,
consensus,
distinction,
étroits-pointus,
gentrification,
hippies,
momies,
patrimonialisation,
ville,
zombitude
Inscription à :
Articles (Atom)
