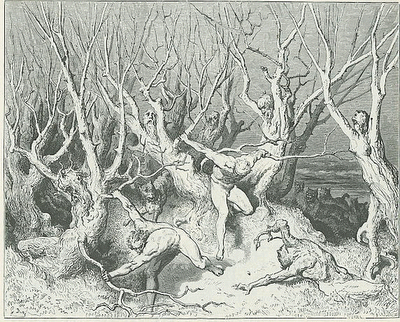Malgré son caractère encore inachevé, ci-dessous un extrait de l'article Wikipedia " Guy Debord " (consulté le 11 janvier 2010) à propos du livre d'Anselm Jappe sur Guy Debord et son concept critique de spectacle comme stade suprême de l'abstraction.
Malgré son caractère encore inachevé, ci-dessous un extrait de l'article Wikipedia " Guy Debord " (consulté le 11 janvier 2010) à propos du livre d'Anselm Jappe sur Guy Debord et son concept critique de spectacle comme stade suprême de l'abstraction.
Anselm Jappe, dans un essai remarqué sur Guy Debord [28], montre que « la compréhension des théories de Debord nécessite avant tout que l'on fixe sa place parmi les théories marxistes » [29]. En effet, à la suite aussi des influences de Henri Lefebvre, Joseph Gabel ou de Socialisme ou Barbarie [30], dès le chapitre deux de La Société du spectacle, Debord s'appuie sur les théories de Karl Marx pour construire sa théorie du Spectacle et parmi les penseurs marxistes, Georg Lukács compte parmi ceux qui ont eu une influence décisive sur ses écrits théoriques. Pour Jappe il faut donc rattacher la théorie du Spectacle à la question de l'analyse de la marchandise, de la valeur et du fétichisme de la marchandise, car Debord s'appuie sur celle-ci pour élaborer son concept critique de spectacle. En recentrant la théorie de Debord sur son rapport à Marx, Jappe montre aussi que le spectacle ne peut pas être réduit à une logique immanente à « l'image » en elle-même comme le pensent certains interprètes, car ce dont veut rendre compte le concept critique de spectacle c'est que « le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images » (thèse 4 de La Société du spectacle). Debord ne traite donc pas du « Spectacle » de manière transhistorique mais en fait une caractéristique essentielle de la société contemporaine. Il ne s'inscrit donc pas dans la continuité des « philosophies de l'image » précédentes et il n'y a aucune haine de l'image chez Debord, comme le montre son oeuvre cinématographique.
Ainsi, la première thèse de La société du spectacle détourne la première phrase du Capital, où l'immense accumulation de marchandises déjà constatée par Marx comme réduction de la vie humaine et de son environnement aux critères purement quantitatifs s'est encore aggravéé dans le cadre d'une société qui ne peut plus proposer la qualité que de manière abstraite c'est-à-dire sur le plan de l'image. En démontrant que Debord s'appuie sur l'interprétation que Lukács fait de la pensée de Marx à travers son indentification de la marchandise « comme catégorie universelle de l'être social total » [31], Anselm Jappe écrit donc que « Le problème n'est pas uniquement l'infidèlité de l'image par rapport à ce qu'elle représente, mais l'état même de la réalité qui doit être représentée », Jappe reconnaissant dans le premier cas « une conception superficelle du fétichisme de la marchandise qui n'y voit qu'une fausse représentation de la réalité » [32]. Et d'ajouter que « ce que Debord critique n'est donc pas l'image en tant que telle, mais la forme image en tant que développement de la forme-valeur » [33] elle-même issue de « la victoire d'anihilation qu'a remportée, sur le terrain de l'économie, la valeur d'échange dressée contre la valeur d'usage » [34], par laquelle se constitue l'économie politique (« [Claude Lefort] impute faussement à Debord d'avoir dit que « la production de la fantasmagorie commande celle des marchandises », au lieu du contraire - ce contraire qui est une évidence clairement énoncée dans La Société du Spectacle, notamment dans le deuxième chapitre ; le spectacle n'étant défini que comme un moment du développement de la production de la marchandise ») [35]. Cette inversion, typique de la société de la marchandise, où le travail concret devient l'attribut du travail abstrait, la valeur d'usage celui de la valeur d'échange, que Marx a analysé dans le premier chapitre du Capital surtout dans sa quatrième partie intitulée « le caractère fétiche de la marchandise et son secret » est reprise pour désigner « le développement le plus extrême de cette tendance à l'abstraction » [36] qu'est le spectacle, et Debord peut dire de celui-ci que son « mode d'être concret est justement l'abstraction" » [37]. La théorie du spectacle de Debord peut donc être interprété comme une description de l'étape ultérieure du développement de l'« abstraction réelle » [38] [39] de la forme-valeur (ou forme-marchandise) [40], de la soumission du corps social à ses lois qui modéle l'ensemble de la société selon ses exigences, non plus seulement dans la sphère de la production mais aussi dans la sphère du « temps libre », par le biais de la fausse cohésion sociale que présente le spectacle qui, à la fois, visualise le lien social aliéné entre les hommes (pour Marx, « le capital est un rapport social entre personnes, lequel rapport s'établit par l'intermédiaires des choses ») et incarne le résultat de la puissance qu'ils contribuent eux-mêmes à édifier ( comme résultat de leurs propres activités inconscientes ) [41] au point que « le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image ». [42]. Cette idéologie sous-jacente, par laquelle la classe bourgeoise impose le résultat irrationnel de son mode de production comme ensemble rationnel cohérent et indiscutable à l'admiration de la foule atomisée où toute communication directe entre producteurs s'est dissoute avec celle des communautés, « dictature totalitaire du fragment » qui masque « les ensembles et leur mouvement » [43], influence à son tour l'activité sociale réelle de sorte que, par « là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels, et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique » [44], l'idéologie se matérialise. Par sa référence explicite à L'essence du christianisme de Ludwig Feuerbach, Debord identifie le spectacle comme la retombée, à un niveau supérieur, de la société dans le mythe, une nouvelle religion (dans le sens de la projection imaginaire de l'homme dans une transcendance dont il ne reconnaît pas qu'elle n'est que l'incarnation de ses propres pouvoirs détachés de lui-même), où l'homme, bien que sujet conscient par rapport à la nature ( « le grand projet de la bourgeoisie ») [45] ne l'est pas encore devenu à l'égard de sa propre production, qui s'impose, alors, comme un nouveau fatum [46]. Debord ne voit, ainsi, dans l'apparition, au début des années soixante-dix, du phénomène de la pollution, « rien de foncièrement nouveau » mais « seulement la fin forcée du processus ancien »; le symptôme d'une société qui n'a pas encore dépassée sa division en classes antagonistes et qui engendre, de ce fait, de nouvelles contradictions résultant du développement purement quantitatif de la marchandise « où l'on a sciemment intégré l'usure aux objets produits aussi bien qu'à leurs images spectaculaires, pour maintenir le caractère saisonnier de la consommation, qui justifie l'incessante reprise de l'effort productif et maintient la proximité de la pénurie », mais qui se transforme, avec le temps, en « réalité cumulative » et « revient sous la forme de la pollution » [47] : « Une société toujours plus malade, mais toujours plus puissante, a recréé partout concrètement le monde comme environnement et décor de sa maladie, en tant que planète malade. Une société qui n'est pas encore devenue homogène et qui n'est pas déterminée par elle-même, mais toujours plus par une partie d'elle-même qui se place au dessus d'elle, qui lui est extèrieure a développé un mouvement de domination de la nature qui ne s'est pas dominé lui-même. Le capitalisme a enfin apporté la preuve, par son propre mouvement, qu'il ne peut plus développer les forces productives ; et ceci non pas quantitativement, comme beaucoup avaient cru le comprendre, mais qualitativement. » [48]
Dans ce contexte d'un « monde réellement renversé » où « le vrai est un moment du faux », Debord rejoint certaines conclusions de Günther Anders dans « l'obsolescence de l'homme » (1956) quand il annonce que « l'histoire des idéologies est finie » [49] : Le « Tout est moins vrai que la somme des vérités de ses parties ou, pour retourner la célèbre phrase de Hegel : « Le Tout est le mensonge, seul le Tout est le mensonge. » La tâche de ceux qui nous livrent l'image du monde consiste ainsi à confectionner à notre intention un Tout mensonger à partir de multiples vérités partielles.» [50];« Notre monde actuel est « postidéologique » : il n'a plus besoin d'idéologie. Ce qui signifie qu'il est inutile d'arranger après coup de fausses visions du monde, des visions qui diffèrent du monde, des idéologies, puisque le cours du monde lui-même est déjà un spectacle arrangé. Mentir devient superflu quand le mensonge est devenu vrai. [51]
Pourtant Anselm Jappe comme Gérard Briche et plus largement les théoriciens de la critique de la valeur (Krisis), considèrent que Debord n'est pas allé au bout du chemin. Pour ces auteurs, on peut ainsi lui reprocher qu'il reste encore dans le marxisme traditionnel quand il ne se déprend pas de la solidarité prolétarienne avec la classe ouvrière (éloge du conseillisme notamment), ou encore que l'ambiguïté du statut de réalité du concept de spectacle, permet la possibilité d'une compréhension idéalisante du fétichisme (mais le concept de spectacle ne théorise pas quelque chose qui serait comme une manipulation mentale, car ce concept n'informe pas une théorie de la communication moderne ou une théorie du dévoiement publicitaire de la politique). Sur le premier point, comme le remarque le philosophe Gérard Briche à la suite de Jappe, à l'inverse de ce que pensait Debord, l'analyse de la marchandise débouche plutôt sur l'idée que « bourgeois et prolétaires ne sont que des agents de fonction du cycle de la valorisation. Et on touche là à l’équivoque de la critique situationniste de la marchandise et de la notion de spectacle. Une équivoque que l’Internationale partage d’ailleurs avec l’ensemble du marxisme traditionnel, y compris dans ses courants hétérodoxes » [52]. Le slogan situationniste « Ne travaillez jamais ! » écrit par Debord en 1953 sur un mur rue de la Seine à Paris, a aussi seulement été développé dans une vision romantique (et certains textes de l'IS adhèrent en même temps à l'utopie libératrice de l'automatisme technologique), en sous-estimant la critique radicale du travail abstrait qu'il y a dans la théorie. C'est à ce débat sur les limites de Debord au regard de la critique de la valeur, que renvoie le dernier chapitre du livre de Jappe, " Passé et présent d'une théorie ". Debord a été aussi fortement influencé par les théories sur Le Soulèvement de la Jeunesse (1949) d'Isidore Isou qu'il a fréquenté au début des années 1950. Dans L'Avant-garde inacceptable. Réflexions sur Guy Debord, Anselm Jappe revient de manière critique sur l'idée que la pensée de Debord serait en cours de « récupération » et de « dissolution » – via la vulgarisation du concept de « spectacle » dans les médias –, en montrant les mésinterprétations courantes du concept de « spectacle » (comme dénaturation de la politique, essor de la publicité, etc.). Restée encore largement incomprise malgré sa relative médiatisation, la pensée de Debord en resterait d'après lui d'autant plus subversive.
NOTES :
[28] Lettres de Guy Debord à Anselm Jappe, Dans Guy Debord, Correspondance, volume 7, janvier 1988-novembre 1994, Arthème Fayard, 2008. Le Magazine littéraire soulignait que « de tous les ouvrages parus sur les idées de Guy Debord, celui d'Anselm Jappe (qui vient d'être réédité) est à ce jour le plus intéressant » (Frédéric Martel, « Analyse d'une pensée "située" », Le Magazine Littéraire, n° 399, 1er juin 2001).
[29] Anselm Jappe, Guy Debord, Denoël, 2001, p. 17.
[30] pour connaître l'ensemble des références explicites ou sous-jacentes de La société du spectacle, cf. Citations et détournements de la société du spectacle
[31] Georg Lukács, Histoire et conscience de classe (1923), éditions de minuit (1960) page 113.
[32] Anselm Jappe, Guy Debord, éditions Sulliver/Via valeriano, 1998, page 197.
[33] Anselm Jappe, Guy Debord, éditions Sulliver/Via valeriano, 1998, page 197.
[34] in Internationale situationniste n°10, mars 1966, page 59, éditions Arthème Fayard (1997), page 471.
[35] In Internationale situationniste n°12, septembre 1969, page 48, éditions Arthème Fayard (1997), page 616.
[36] Anselm Jappe, Guy Debord, éditions Sulliver/Via valeriano, page 31.
[37] Guy Debord, La société du spectacle, chapitre I, thèse 29
[38] expression d'Alfred Sohn-Rethel dont on pouvait trouver le concept chez Marx en ces termes : « ceux qui considèrent l'autonomisation de la valeur comme simple abstraction oublient que le mouvement du capital industriel est cette abstraction en actes » Karl Marx, Le Capital, livre II.
[39] Anselm Jappe cite, dans un autre de ses livres, Les Aventures de la marchandise (éditions Denoël, 2003, page 219), le penseur Hans-Jürgen Krahl, élève de Theodor W. Adorno, qui analyse dans Konstitution und Klassenkampf comment, à travers ce procès d'abstraction qui se soumet la réalité entière, le capitalisme devient la métaphysique réalisée : « Chez Hegel, les hommes sont les marionnettes d'une conscience qui leur est supérieure. Mais selon Marx, la conscience est le prédicat et la propriété d'hommes vivants. [...] L'existence d'une conscience métaphysique et supérieure aux hommes est une apparence, mais une apparence réelle : le capital. Le capital est la phénoménologie existante de l'esprit, il est la métaphysique réelle. Il est une apparence, parce qu'il n'a pas de véritable structure de chose, et pourtant il domine les hommes »
[40] cf. Guy Debord, La société du spectacle, chapitre II, thèse 38.
[41] cf. Guy Debord, La société du spectacle, chapitre I, thèse 30.
[42] Guy Debord, La société du spectacle, chapitre I, thèse 34
[43] in Internationale situationniste n°8, janvier 1963, page 33, éditions Arthème Fayard (1997) page 329
[44] Guy Debord, La société du spectacle, chapitre I, thèse 18
[45] in Internationale situationniste n°8, janvier 1963, page 4, éditions Arthème Fayard (1997), page 300.
[46] Lukács décrit ainsi cette nouvelle situation : « Car, d'une part, les hommes brisent, dissolvent et abandonnent toujours plus les liens simplement « naturels », irrationnels et « effectifs », mais, d'autre part et simultanément, ils élèvent autour d'eux, dans cette réalité créée par eux-mêmes, « produites par eux-mêmes », une sorte de seconde nature dont le déroulement s'oppose à eux avec la même impitoyable conformité à des lois que le faisaient autrefois les puissances naturelles irrationnelles (plus précisément : les rapports sociaux qui leur apparaissaient sous cette forme). « Leur propre mouvement social, dit Marx, possède pour eux la forme d'un mouvement des choses, sous le contrôle desquelles ils se trouvent au lieu de les contrôler » Histoire et conscience de classe (1923), éditions de minuit (1960) page 163.
[47] Guy Debord, Gianfranco Sanguinetti, Thèses sur l'internationle situationniste et son temps, thèse 16, InLa véritable scission dans l'internationale, éditions Champ libre, avril 1972 ; éditions Arthème Fayard, 1998, page 32-33. Internationale situationniste,
[48] Guy Debord, La planète malade (texte inédit de 1971), éditions Gallimard, 2004, page 83.
[49] Guy Debord, La société du spectacle, chapitre IX, thèse 213.
[50] Günther Anders, L'obsolescence de l'homme, (1956), éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 2002, page 188.
[51] Günther Anders, L'obsolescence de l'homme, (1956), éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 2002, page 224-225.
[52] Gérard Briche, " Le spectacle comme réalité et illusion " , Colloque Guy Debord 2007